« Décivilisation », guerre en Ukraine, naufrages en Méditerranée… Le philosophe Étienne Balibar explore les conditions d’une « cosmopolitique » susceptible de dévier le cap au pire. Entretien.
29 juin 2023 à 15h02
LeLe philosophe Étienne Balibar, dont les écrits sont publiés par les éditions La Découverte en plusieurs volumes (Histoire interminable, Passions du concept, et désormais Cosmopolitique), revient pour Mediapart sur la notion de « décivilisation », les pratiques de violence et de contre-violence, l’espoir d’une paix qui ne soit pas du pacifisme abstrait, les raisons pour lesquelles la droite libérale est devenue otage de thématiques d’extrême droite. Mais aussi les pistes possibles pour constituer l’humanité en sujet politique capable d’affronter des catastrophes et des événements qui se situent à l’échelle mondiale.
Mediapart : En rapport avec vos réflexions sur la violence et la civilité, que pensez-vous du terme de « décivilisation » employé récemment par Emmanuel Macron ?
Étienne Balibar : On ne peut pas réagir au quart de tour chaque fois que le président de la République – ou son équipe de communication – joue, avec une certaine habitude du métier, sur deux tableaux à la fois : envoyer un signal reçu cinq sur cinq par l’extrême droite tout en émettant l’idée qu’on s’inscrirait dans des grands débats intellectuels. Mais je veux bien jouer le jeu avec vous.
Il existe évidemment des formes de violence dans notre société. Elles sont nombreuses et hétérogènes, tantôt visibles, voire médiatisées, tantôt invisibles ou sous-estimées, comme les violences de genre. Ce n’est pas à cela que le président de la République a voulu s’attaquer, mais à une prétendue subversion qui menacerait notre société et sa culture historique.
Or, si on veut parler de l’extrême violence contemporaine, parlons-en. Il faut par exemple regarder ce qui se déroule en Méditerranée. J’ai employé dans des interventions publiques, reprises dans mon livre, des mots forts, en parlant de la « dimension génocidaire » de la véritable guerre conduite contre les « errants ». C’est peut-être forcé.

Mais les opérations de pushback ou l’absence délibérée de secours aux bateaux de réfugiés, comme hier en Grèce, constituent des crimes et des formes de violence extrême. Il en va de même, toute proportion gardée, pour les violences policières auxquelles on assiste en France depuis quelque temps.
Mais le problème n’est pas seulement celui de la violence du système, c’est celui de la violence qu’on croit pouvoir lui opposer. Il y a quelques années, j’ai commencé à parler de « civilité » pour désigner l’ensemble des stratégies qui visent à empêcher la politique de s’effondrer dans la violence.
J’ai même parlé de « civiliser la révolution ». C’était prendre le risque de passer pour un avocat de la non-violence. De Gandhi à Martin Luther King et à Mandela, on ne compte plus les exemples qui démontrent que celle-ci constitue une arme politique fondamentale dans les combats pour les droits humains.
La violence politique n’est pas un instrument “neutre”, dont on se servirait impunément.
Mais par civilité j’entends plutôt une « anti-violence », qui peut et doit revêtir différentes formes, suivant les circonstances. Mon idée était de caractériser un concept politique suffisamment complexe et dialectique pour affronter la violence sans en être le prisonnier.
J’ai suffisamment lu Marx et étudié l’histoire pour savoir que, lorsqu’on se bat pour une cause juste, on n’a pas souvent le choix des moyens. Mais il m’a semblé que Lénine, en expliquant que la violence est l’instrument nécessaire à la transformation révolutionnaire de la société, n’a pas saisi, comme l’a fait Gandhi, que la violence politique n’est pas un instrument « neutre », dont on se servirait impunément, sans que cela ait d’effet en retour sur ceux qui s’en servent. Pour le dire comme Max Weber, « qui veut dîner avec le diable doit se munir d’une longue cuillère ».
Dans un entretien que vous nous aviez accordé l’an dernier, vous jugiez, au moment où débutait la guerre en Ukraine, que le pacifisme n’était pas une « option ». Êtes-vous toujours sur cette position ?
Oui, je fais partie de ceux qui, à gauche, jugent que, face à cette guerre, le pacifisme n’est pas une option. Cela n’empêche pas que nous sommes dans un engrenage catastrophique, dont une conséquence va être la militarisation à outrance des États dans lesquels nous vivons, et de l’Europe comme telle.
C’est en fait une situation générale, qui produit un état d’exception permanent aux quatre coins du monde, tissé de guerres civiles ou entre États, de guerres de haute ou basse intensité, de militarisation des frontières, de crime organisé, de tueries périodiques dans certains pays bourrés d’armes à feu individuelles, dont le résultat est une production d’armements toujours croissante, du revolver à la bombe atomique, qui ne peut qu’avoir des effets politiques dans un futur proche.

En mordant le trait, il me semble aussi que cette prolifération des armes et des conflits armés est corollaire d’un retour en force de la virilité comme culture des sociétés dans lesquelles nous vivons, perpétuant de grandes structures anthropologiques où les hommes assoient leur domination sur la fonction guerrière. Je ne peux m’empêcher de penser que les guerres qui nous entourent correspondent aussi à une forme de backlash face aux avancées du féminisme dans le monde, en réaffirmant une forme de domination virile très profondément remise en cause au cours du siècle dernier.
Il n’en reste pas moins que le pacifisme n’est pas une option, si l’on entend par là une façon de ne pas prendre parti et de laisser les Ukrainiens se débrouiller seuls face à leur agresseur.
Cependant, n’étant pas chef d’État ou diplomate, je n’ai pas à me plier aux conventions qui interdisent de prononcer le mot de « paix » parce qu’il est rejeté par l’Ukraine qui y voit une injonction de passer un compromis avec la Russie aux dépens de ses intérêts nationaux. Sans vouloir jouer les stratèges, il me semble important de poser d’ores et déjà la question de savoir comment on pourra sortir de cette guerre.
Nous sommes face à une pression quotidienne pour considérer qu’il existe une guerre de civilisation entre les Russes et les Occidentaux dont la frontière passerait dans le Donbass.
Un autre aspect très important à mes yeux est qu’une situation de guerre oblige à désigner des amis et des ennemis. En tant qu’internationaliste invétéré et citoyen européen convaincu, je ne veux pas désigner le peuple russe comme mon ennemi. La position de ceux qui, dans ladite « gauche mondiale », par opposition aux États-Unis ou à l’Otan, modèrent ou refusent leur soutien à l’Ukraine, est indéfendable à mes yeux. Mais nous sommes aussi face à une pression quotidienne pour considérer qu’il existe une guerre de civilisation entre les Russes et les Occidentaux dont la frontière passerait dans le Donbass.
C’est une aberration à mes yeux. La Russie tout entière fait partie de l’espace historique européen. Il faut espérer, même si c’est difficile, que le peuple russe soit capable de se défaire lui-même du régime qui lui impose aujourd’hui sa loi, et il faut l’y aider en renforçant les communications avec lui.
Cet événement guerrier au cœur de l’Europe éloigne-t-il la possibilité de la « cosmopolitique » que vous appelez de vos vœux dans votre dernier ouvrage ?
Au contraire, les événements catastrophiques qui fractionnent l’humanité en « camps » inconciliables sont l’objet même de la cosmopolitique. Ce terme, de plus en plus souvent utilisé aujourd’hui, par-delà les divergences théoriques de ceux qui l’emploient, veut à la fois conserver quelque chose du cosmopolitisme traditionnel et le repenser. Ses insuffisances, voire ses détournements, mais aussi ses principes fondamentaux – comme le principe kantien de ne pas transformer l’étranger quel qu’il soit en ennemi –, appellent tout un travail critique auquel j’ai essayé de contribuer.
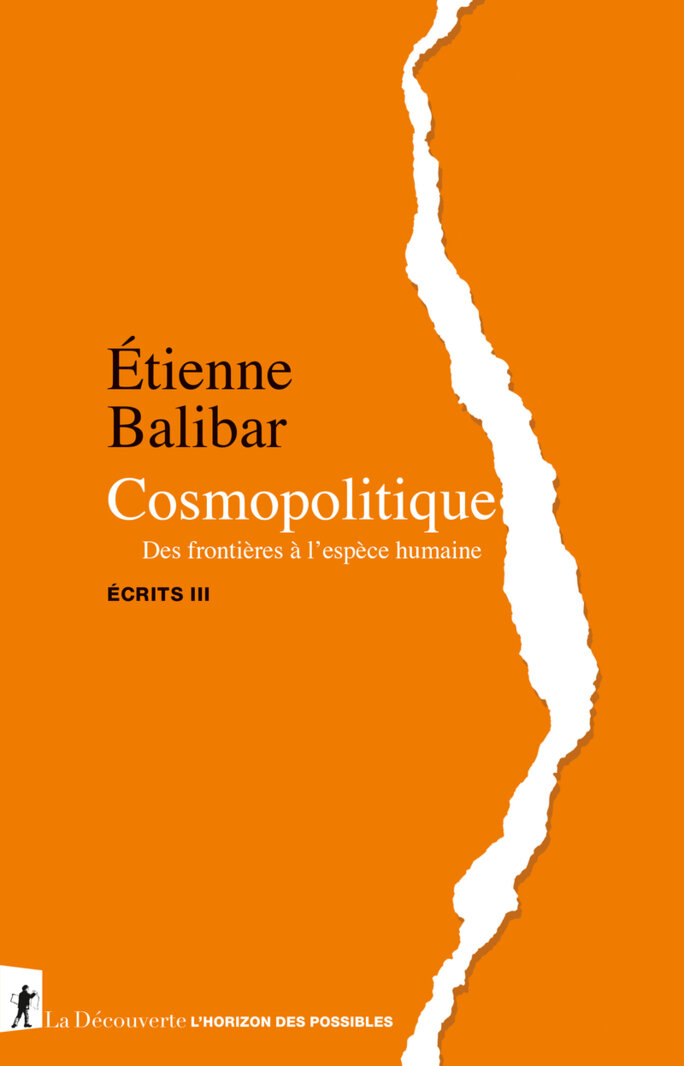
La question centrale est bien de savoir comment constituer l’humanité en sujet politique, pour faire face à des guerres mondialisées, aux migrations internationales, au bouleversement climatique ou aux pandémies qui affectent l’humanité dans son entier, sans oublier les gigantesques inégalités sociales et économiques entre le Nord et le Sud. Il faut inventer une culture, un langage politique adaptés à des intérêts et à des conflits mondiaux.
Le fond du problème est que ce sujet politique potentiel n’est pas constitué comme un acteur unique et cohérent, et qu’à chaque fois que se pose la nécessité d’une action concertée de tous les habitants de la planète, ce qui surgit d’abord est la profondeur des divisions qui les séparent.
La cosmopolitique n’est pas une notion bien-pensante et attrape-tout, c’est un point de vue critique et totalisant qui permet de dépasser la notion de géopolitique centrée sur les seuls intérêts des États. La tradition marxiste a certes essayé d’opérer un renversement en imaginant une géopolitique des peuples, mais celle-ci n’a pas été en mesure d’empêcher les puissances impérialistes de déclencher la Première Guerre mondiale.
De même, après l’essor du grand mouvement de décolonisation, l’internationalisme des « damnés de la terre » a sombré, comme le craignait Fanon, dans une nouvelle forme de nationalisme et de souverainisme. La cosmopolitique essaie de remettre la question sur le métier et de faire éclater ce cadre et les frontières qui le structurent, afin de penser les intérêts de l’humanité autrement qu’à travers les intérêts nationaux ou les seuls intérêts de classe.
Dans le chapitre de votre livre qui revient sur le coronavirus, vous jugez que la « construction du commun suppose une révolution dans la liste des droits fondamentaux, de façon à en extraire la propriété et à l’assujettir à des règles de priorité de l’intérêt sanitaire sur l’intérêt propriétaire ». Cette priorité de la propriété est-elle à mettre en cause dans d’autres domaines ?
Sûrement. Mais c’est enfoncer une porte ouverte puisque nos propres dirigeants n’ont pas manqué, au début de la pandémie, de nous expliquer qu’il existait des domaines dans lesquels le droit de propriété devait rencontrer des limites. Il doit exister des « biens publics mondiaux », même s’il y a divergence sur la définition.
Certains insistent sur le fait que la gestion de ces biens communs implique des formes d’autogestion démocratique et d’autres ne voient pas comment on pourrait se passer d’une gestion étatique. Il y a des difficultés des deux côtés : l’autogestion est impraticable au-delà des petites communautés, et l’idée de pouvoirs ou de services publics supranationaux est obscure.
La question centrale est de faire émerger et d’inscrire dans les faits des valeurs et des principes juridiques contraignants qui limitent la toute-puissance de la propriété privée. La question a été posée lorsque l’Afrique du Sud et l’Inde, qui en avaient les capacités technologiques, ont réclamé la levée des droits de propriété intellectuelle exclusifs pour des produits médicaux comme les vaccins, dont toute l’humanité a besoin et que les populations pauvres ne peuvent pas payer au tarif des grands trusts pharmaceutiques.
Mais il existe d’autres domaines que les brevets et les médicaments dans lesquels le droit de propriété doit être remis en cause. La lutte contre le bouleversement climatique, dont je commence à désespérer qu’elle ait vraiment lieu, impliquerait de considérables avancées dans la limitation de l’absolutisme du droit de propriété par comparaison à d’autres droits aussi fondamentaux, voire davantage : droit aux ressources rares et à leur préservation, droit au cadre de vie, droit à la santé, droit à la communication…
Dans la théorie marxiste, telle qu’elle a été interprétée historiquement, l’abolition de la propriété privée c’est le transfert du droit de propriété à l’État, suivant une logique tout aussi monopolistique. Alors qu’il s’agit aujourd’hui de réfléchir à comment diviser et partager la propriété. La propriété est un concept juridique complexe, qui ne désigne pas seulement la souveraineté sur des biens, mais aussi des obligations et des contraintes insérées dans des échanges avec d’autres partenaires sociaux, publics et privés, individuels et collectifs.
Des philosophes comme Catherine Colliot-Thélène hier ou Pierre Crétois aujourd’hui ont réfléchi à ce concept « absolutiste » de propriété et à la manière dont il a été érigé en modèle de tous les droits subjectifs, y compris pour des « biens » qui ne sont pas du tout de même nature. L’histoire de la rédaction de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 est à cet égard fascinante. L’article final qui énonce que la propriété individuelle constitue un droit « inviolable et sacré » a failli ne pas y figurer. C’est un ajout de dernière minute, en forme de coup de théâtre, qui arrive après une multitude de débats sur le sujet.
Mais la libre parole ou la libre association sont des biens communicationnels fondés sur la reconnaissance mutuelle qui n’engagent pas le même type de liberté ou de sécurité que celle de ne voir pas d’intrus pénétrer dans sa maison. Même chose pour le droit des ouvriers à revendiquer quelque chose comme une « propriété sociale » en contrepartie de leur travail.
Ce qui a aujourd’hui le vent en poupe en Europe, ce sont des mobilisations identitaires et xénophobes dont vous écrivez qu’elles « dessinent le tableau d’un cosmopolitisme inversé ». Que peut la cosmopolitique face à cela ?
À propos de la nation, je serais tenté de dire ce que je disais de la propriété : il faut sortir des alternatives abstraites même quand elles ont une histoire longue dont il est difficile de s’extraire. Je n’ai pas du tout renoncé à me penser comme un internationaliste. La montée du nationalisme dans des formes xénophobes m’inquiète, me désespère, mais me renforce aussi dans ma conviction qu’il ne faut pas partir battu d’avance.

Si le nationalisme a de l’avenir, l’internationalisme aussi, à condition de le construire à une échelle quotidienne, en résistant par exemple à l’idée que l’étranger est un ennemi potentiel. Ainsi, on ne « protège » pas seulement les étrangers, mais on sauve « l’étrangèreté ». On défend l’idée que c’est bon pour tous qu’il y ait cohabitation des « nationaux » avec des « étrangers ».
Le nationalisme se construit sur une sorte de double sentiment d’appartenance. Les nationaux sont imbus de l’idée que le territoire qu’ils habitent est à eux de façon exclusive et que l’État leur appartient en propre. Inversement, l’État est convaincu que les personnes qui habitent le territoire dont il revendique la souveraineté lui appartiennent. D’où la suspicion envers les personnes qui ont des nationalités multiples ou vivent de part et d’autre des frontières.
Le souverainisme compense aujourd’hui ses propres insuffisances par un surcroît de nationalisme.
Or cette idée est totalement irréelle face aux grands problèmes du monde actuel : la mondialisation de l’économie, la circulation des individus, le climat, la santé, même la langue et donc la culture… Ce sont des questions qu’on ne peut gérer en suivant le modèle de la propriété territoriale exclusive, mais au contraire du partage de souveraineté et de l’échange.
Le souverainisme compense aujourd’hui ses propres insuffisances par un surcroît de nationalisme qui nourrit la xénophobie. Dès qu’un problème est hors de portée de l’État national ou révèle son impuissance, on parle d’invasion, on fait de l’hybridité ou du mélange le danger premier contre lequel se prévenir, on cherche des boucs émissaires et cela peut aller très loin. Je ne vois pas ce qui nous prémunirait contre une situation où l’on verrait des pogroms en France.
Pour « résister » à ces nationalismes, il est urgent de réfléchir aux formes pratiques de l’internationalisme, qui réside peut-être aujourd’hui moins du côté de la classe ouvrière que des Soulèvements de la Terre, même si je demeure perplexe sur le fait qu’un internationalisme environnemental ne se développe pas plus rapidement. Il est vrai que ses ennemis sont nombreux à vouloir l’empêcher.
Dans un contexte où les « errants », pour reprendre votre terme, meurent dans l’indifférence comme on l’a encore vu récemment en Grèce, et où leur installation dans les pays européens suscite des résistances parfois violentes, votre espoir de voir émerger un « droit international de l’hospitalité » peut-il être autre chose qu’un vœu pieu ?
Si on regarde un pays comme la France, ou certains de ses voisins européens, on peut se demander pourquoi des gouvernements qui se revendiquent du libéralisme sont devenus à ce point-là les otages d’une pensée d’extrême droite, xénophobe, raciste et focalisée sur les questions de migrations et de réfugiés.
La fameuse phrase d’Angela Merkel « Nous y arriverons ! » (« Wir schaffen das ! ») ne date pas du siècle dernier et elle a permis l’accueil de plus d’un million de réfugiés de Syrie et du Proche-Orient en Allemagne. C’est plutôt une réussite. Mais quand elle a dit cela, deux chefs de gouvernement se sont précipités à Munich pour dire que cette politique était une aberration qui ne devrait surtout pas servir de modèle en Europe : Viktor Orbán et Manuel Valls, qui n’avait pas été alors démenti par le président socialiste de l’époque.
Pourquoi la classe politique, jusqu’à une partie de la gauche, est-elle devenue l’otage de la xénophobie de droite ? Poser la question, c’est déplacer le curseur d’un cran, et y voir un des signes de la dégénérescence des systèmes politiques dans lesquels nous vivons. Quelles en sont les origines ?
Parmi d’autres facteurs, il y a selon moi le fait que l’appartenance à la nation garantissait un certain nombre d’acquis sociaux et que, réciproquement, la jouissance de certains droits sociaux constituait une forme d’intégration du peuple à la nation. C’est ce que j’ai appelé l’État national-social, et que le néolibéralisme a entrepris de démanteler. D’où une insécurité et un ressentiment très profonds.
Le problème n’oppose pas une « France périphérique » à une autre. C’est le cœur même de la société du travail qui se sent agressé et menacé dans ses conditions de vie, son statut, sa reconnaissance… Sans alternative crédible, je crains parfois que la phrase terrible de Marx, décrivant la paysannerie comme une classe fondamentalement « réactionnaire » parce qu’elle n’aurait pas d’avenir mais seulement un passé à défendre, ne puisse être étendue à toute une partie de la classe laborieuse.

Tout n’est pas perdu cependant. La mobilisation contre la réforme des retraites a montré qu’il existait dans ce pays des forces organisées, mobilisées pour résister à la décomposition de l’État social. Il existe donc des ressources politiques, mais la résistance au nationalisme exige quelque chose de plus, des idéaux, des perspectives d’avenir qui fassent contrepoids au néolibéralisme et à la désespérance qu’il engendre.
On dira que ce sont des mots, mais je ne suis pas convaincu du tout qu’invoquer la force morale de certaines idées soit de l’idéalisme pur et simple. Si on regarde le socialisme du XIXe et du XXe siècle, on ne trouve pas plus idéaliste : des millions de gens se sont mobilisés en croyant à une espérance et pas du tout seulement par l’effet de la condition sociale dans laquelle ils se trouvaient. Les idées, comme disait Marx, se sont emparées des masses et sont devenues des forces matérielles.
Vous écrivez aussi que la « pandémie n’est pas une “crise” au sens classique dont le capitalisme se “sert” pour se perfectionner ». Qu’entendez-vous par là ?
La pandémie a été souvent présentée comme un résultat de la catastrophe environnementale elle-même causée par le capitalisme. Il me semble que les chaînes causales sont plus compliquées que cela, avec des boucles d’action réciproques.
Comme pour la guerre généralisée, l’essentiel me semble être qu’aujourd’hui le problème des conséquences déborde celui des causes. Le marxisme et le socialisme traditionnel raisonnent selon un schème linéaire où il « suffit » de supprimer la cause de la misère, de la surexploitation ou de la domination pour en faire disparaître les effets. On abolirait le capital et ensuite on serait heureux et libres.
Il s’agit là d’une métaphysique qui remonte loin, déjà très présente dans la tradition utopique. Le livre de Thomas More est entièrement construit sur cette idée : si l’on transporte la population dans un lieu où la propriété privée n’existe pas, la misère et la violence disparaissent d’elles-mêmes.
On peut tenir ensemble l’idée de la responsabilité du capitalisme mondialisé et la nécessité d’initiatives qui combattent chaque situation et chaque violence spécifique.
Je crois de plus en plus que cette logique ne suffit pas. Les causes existent bien sûr et renforcent les conséquences en se perpétuant. Mais les conséquences vont plus loin. Les conséquences des conséquences ont leur propre fatalité, elles s’autonomisent.
La traduction politique de cette idée est que l’apartheid vaccinal, l’usage des frontières pour faire la guerre aux errants ou l’augmentation des inégalités globales appellent une lutte directe qui les affronte comme telles, en fonction de leurs logiques et de leur conflictualité propres, sans attendre d’avoir levé toutes les causes qui les font exister : le capitalisme, le racisme, le patriarcat, etc.
On pourrait m’opposer qu’il s’agit alors de réformisme, dans la mesure où celui-ci préfère toujours s’attaquer aux conséquences plutôt qu’aux causes. Mais je pense qu’on peut tenir ensemble l’idée de la responsabilité du capitalisme mondialisé et la nécessité d’initiatives qui combattent chaque situation et chaque violence spécifique.
Je retrouve la formule souvent reprochée par les révolutionnaires au « révisionniste » Eduard Bernstein : « Le mouvement est tout, le but final n’est rien », et je crois qu’on peut la fusionner avec la célèbre définition de Marx : « Le communisme n’est pas un régime que nous cherchons à imposer du dehors, c’est le mouvement réel qui abolit l’état de choses existant. » À condition que le mouvement soit réel, bien sûr.


