La guerre en Ukraine pose les questions de la proximité par l’image, de la ressemblance et de la dissemblance ou encore de l’accueil inégal des réfugiés en fonction de leurs origines, explique la philosophe Hélène L’Heuillet, dans un entretien au « Monde ».
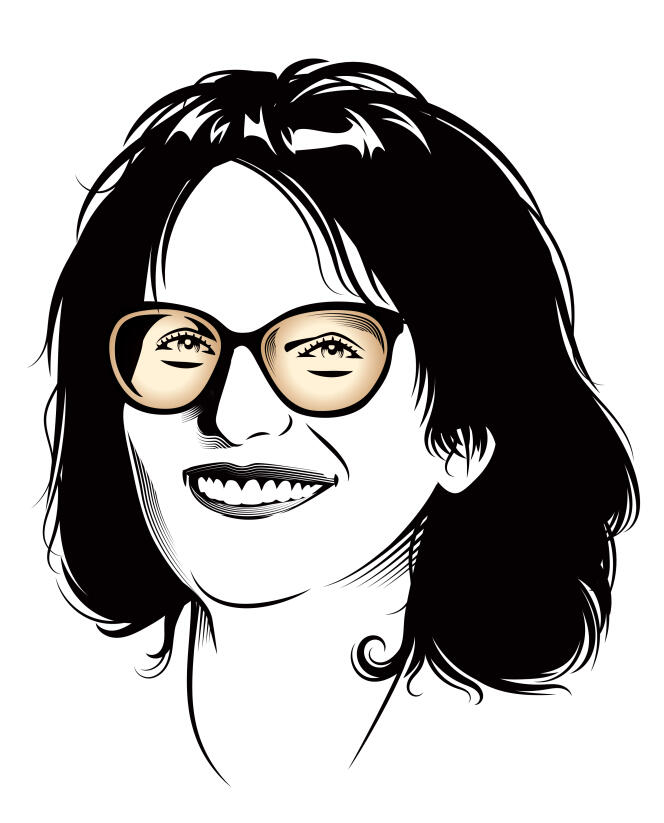
Hélène L’Heuillet est maîtresse de conférences en philosophie politique et éthique à Sorbonne-Université, et psychanalyste, membre de l’Association lacanienne internationale. Ses travaux portent sur le lien social et la violence, le voisinage et les affects politiques, et le rapport contemporain à la temporalité. Situant sa réflexion à la lisière de la philosophie et des sciences sociales, elle a notamment publié Du Voisinage. Réflexions sur la coexistence humaine (Albin Michel, 2016), Tu haïras ton prochain comme toi-même (Albin Michel, 2017) et Eloge du retard. Où le temps est-il passé ? (Albin Michel, 2020).
La généralisation du téléphone portable semble transformer aujourd’hui l’ensemble des humains en voisins proches. La tragédie de l’Ukraine en est une illustration, avec des effets à la fois politiques et psychiques…
Oui, c’est un phénomène particulièrement net pour cette guerre, que nous visualisons en temps réel, en assistant presque en direct aux bombardements. Au XVIIIe siècle, Emmanuel Kant disait déjà, dans son projet de « paix perpétuelle », qu’en vertu de la rotondité de la Terre, l’autre ne pourrait jamais être tout à fait un étranger et que les secousses politiques se produisant dans un endroit seraient ressenties partout.
Mais la grande différence est qu’à son époque il fallait du temps avant d’apprendre la survenue d’un événement. Nous, les secousses, nous les vivons en direct. Cela passe par le fait de voir et d’entendre les personnes concernées et de pouvoir nous identifier à elles. Nous avons tous vu ces bâtiments éventrés, ces gens terrifiés… C’est à juste titre que cela nous plonge dans un état d’angoisse, car heureusement que nous ne sommes pas immunisés – du moins pas entièrement !
Quant aux conséquences en matière de santé mentale, on ne peut pas généraliser car chacun réagit de manière différente. Après le 11-Septembre, certaines personnes ont été traumatisées par les seules images. Cela peut aussi se produire pour la guerre en Ukraine. Mais ma crainte serait plutôt qu’à force de voir ces images, on s’y habitue, malgré notre empathie.
D’autres drames comme ceux de la Syrie, du Yémen ou du Sahel, permettent la même proximité par l’image, mais n’ont pas déclenché le même élan de solidarité que pour l’Ukraine.
Le voisinage est en effet une notion complexe et relative. Mentalement, c’est l’espace entre un point que j’identifie comme « chez moi » et un autre point qui est « chez l’autre », les deux étant séparés par une ligne. Mais les variations d’échelle font que « chez moi », cela peut-être mon logement, mais aussi ma rue, ma ville, mon pays ou ma région du monde.
Et de profondes différences existent selon le type de relation entretenue : le voisin peut être celui avec qui je sympathise, ou celui que je méprise, celui qui me fait peur, celui qui m’indiffère, etc. Il y a donc « voisins » et « voisins ». Le cas des Ukrainiens motive une montée de générosité réconfortante mais qui a fait défaut pour d’autres populations.
Cette sélectivité tient, au moins en partie, à des réflexes de racisme et de xénophobie, même si, dans ce cas particulier, il faut accorder un certain crédit à l’argument géographique : l’Ukraine formant une zone tampon entre la Russie et le reste du continent européen, il est normal de prêter main-forte à ses habitants puisqu’ils nous protègent. Ajoutons néanmoins que cela devrait conduire à accueillir sans différenciation tous ceux qui viennent de ce territoire. Ce qui n’est pas le cas, puisque la protection temporaire accordée par l’Union européenne aux réfugiés reste, jusqu’à présent, refusée à ceux qui résidaient en Ukraine sans en avoir la nationalité.
Les images soulignent notre ressemblance avec les Ukrainiens. Leurs villes dévastées montrent les mêmes stations-service, centres commerciaux, pavillons de banlieue et barres de HLM que les nôtres et suscitent une forte identification.
La ressemblance joue beaucoup, en effet, dans le fait qu’on sent proches voisins des Ukrainiens. Mais le problème avec l’identification, c’est qu’au bout d’un moment, on finit toujours par tomber sur du dissemblable. C’est d’ailleurs tout le problème du culte de l’identité. On pense le voisinage sur le mode de la ressemblance. Il faudrait arriver à le penser sur le mode de l’altérité.
Avec la ressemblance, on est d’abord très content de trouver quelqu’un comme soi. Puis on trouve qu’il l’est peut-être trop, ou alors finalement pas assez. On se regarde, on se compare et de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il serait bien plus raisonnable d’admettre que le voisin n’est pas nécessairement semblable mais autre. Il y a, dans le voisinage, une dialectique essentielle entre l’altérité et la ressemblance. Finalement, on est ressemblants parce qu’on est tous autres. Sans altérité, on meurt, c’est ce que Claude Lévi-Strauss a montré pour les sociétés. A ne vivre que dans l’entre-soi, on étouffe.
Le xénophobe ordinaire vous opposerait sa préférence envers ceux qu’il trouve vraiment ressemblants.
Le xénophobe ordinaire ne se rend pas compte à quel point il est lui-même intéressé par l’altérité qu’il refuse. Au fond, il y pense tout le temps, un peu comme les puritains avec le sexe. L’obsession des particularités, ce que Sigmund Freud appelle le « narcissisme des petites différences », cela fabrique une altérité vécue négativement. Le xénophobe aime accentuer son identité particulière, mais c’est une satisfaction dans laquelle il se dissocie de lui-même. L’altérité est notre loi.
Quand on la refuse au-dehors, on la fabrique au-dedans. La xénophobie est une grande passion triste. Et elle est invivable car cette haine de l’autre, c’est aussi, à un moment donné, une haine de l’altérité en soi. Certains poussent le délire jusqu’à imaginer une souche originelle et pure dont ils seraient les représentants. Le rejet de l’étranger n’est pas une option viable, ni sur le plan personnel, ni sur le plan collectif.
S’agissant de l’immigration, le politique dirait, pour sa part, qu’il se préoccupe avant tout de ce qui lui paraît gérable ou pas.
Les décisions publiques reposent souvent sur de fausses évidences, comme celle de la ressemblance comme critère d’accueil des étrangers. Ces décisions reposent sur des logiques comptables qui ont certainement leur importance dans les techniques de gouvernement, mais n’ont pas à s’imposer à toute la société. Il nous manque aujourd’hui ce que Kant appelait des « idées régulatrices ».
On sait bien qu’elles ne seront pas appliquées entièrement ni du jour au lendemain, mais elles peuvent contribuer à donner une direction différente aux politiques publiques. Par exemple, on peut dire que le xénophobe se trompe en voulant nous étouffer dans l’entre-soi et que le gestionnaire qui organise le rejet des migrants ne fait guère mieux. Les logiques comptables ont toujours une partie idéologique qui n’est pas explicitée.
Mais d’autres idées doivent circuler dans le champ social et déjouer le vocabulaire formaté auquel on veut nous soumettre. Espérons que l’accueil des Ukrainiens serve à mieux accueillir d’autres populations, qu’il puisse réconcilier les Français avec l’altérité, leur montrer qu’elle ne dégrade pas leurs conditions de vie. C’est cela, le rôle d’une idée régulatrice.
La Russie poutinienne s’est attaquée à plus qu’un voisin : un vrai pays frère, par la langue, la culture, l’histoire, les paysages, les parcours individuels et même les nombreux liens familiaux. La ressemblance n’a pas été un frein à la violence.
La ressemblance est beaucoup plus grosse d’hostilité qu’on ne le croit généralement. Les conflits fratricides sont souvent les plus cruels, car ils font intervenir, en plus des autres motifs, le rapport à la filiation. Lequel est le meilleur fils ? Lequel a droit à l’héritage ? Vladimir Poutine se revendique d’ailleurs comme le vrai héritier à la fois de l’Union soviétique et de l’empire des tsars. Il se réclame de cette filiation historique et désigne en quelque sorte les Ukrainiens comme les mauvais fils qu’il se fait fort de remettre dans le droit chemin.
La manière dont Vladimir Poutine et ses soutiens inversent le langage, avec un aplomb terrifiant, participe de la sidération qu’on ressent à propos de ce conflit.
C’est très au-delà du mensonge ordinaire, au-delà de ce qu’on a appelé la « post-vérité », ce mépris des faits apparu en 2016 dans les campagnes de Donald Trump aux Etats-Unis et du Brexit au Royaume-Uni. Celui qui commet un crime avéré accuse sa victime du crime qu’il est en train de commettre et assène cette accusation à la face du monde. Cette logique totalement perverse détruit le langage et pousse tous les protagonistes à la folie.
Le message que fait ainsi passer l’auteur du crime est qu’il ne demande même pas qu’on le croie, qu’il ment tranquillement et que ce qu’on peut en penser lui est égal. Cette façon de retourner les faits, de dire par exemple que les bombardés se bombardent eux-mêmes agit au-delà du langage puisqu’elle consiste de la part du locuteur à se proclamer, et peut-être à se croire, plus fort que la réalité. Cette perversion du langage abolit toute limite et nous menace tous, d’autant qu’elle est susceptible de créer des émules.
Malheureusement, elle est aussi payante puisqu’elle rencontre un fond complotiste déjà présent et qu’une partie du public va penser qu’après tout, on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé. Et même si l’on est conscient que Vladimir Poutine ne dit jamais la vérité, on peut être piégé en restant suspendu à sa parole tout en ne sachant jamais ce qu’il va faire.
De nombreux Ukrainiens se déclarent effarés de constater que leurs proches en Russie refusent de les croire lorsqu’ils racontent ce qu’ils vivent et préfèrent s’en tenir à la propagande officielle.
Cela, c’est vraiment la destruction du lien, qui est fondé sur l’acceptation de l’altérité. Au fond, ce qui nous fait tous voisins, ce n’est pas seulement la rotondité de la Terre, c’est que nous sommes des êtres de parole, ce qui nous oblige à une éthique minimale qui est de se croire. On se croit les uns les autres. Cela ne veut pas dire qu’on se croit entièrement, partout et sur tout. Le mensonge existe, que ce soit dans les relations privées ou la politique.
Mais si votre prochain vous alerte sur le fait qu’on est en train de le tuer, c’est autre chose, il faut l’entendre et lui accorder un minimum de crédit. Si votre propre famille ne vous croit pas lorsque vous lui dites ce que vous vivez, alors un élément du pacte inter-humain est rompu. Ce pacte fait que l’on parle le même langage, pas forcément dans la même langue, et que l’on se réfère à une base de réalité commune même s’il peut y avoir des malentendus ou des erreurs. Cette rupture creuse un fossé infranchissable.
Elle suscite chez celui qui n’est pas cru un profond désespoir qui peut se muer en rage. Les rescapés des camps de concentration et d’extermination ont fait l’expérience de ne pas pouvoir être entendus parce que leur récit dépassait ce qu’on pouvait entendre. C’est peut-être aussi en partie ce qui se passe dans cette situation ukrainienne, où les devoirs premiers de l’humanité ne sont décidément pas respectés.
Luc Cédelle


