Cinquante ans après le coup d’État du général Pinochet, retour avec l’historien Franck Gaudichaud sur l’expérience de l’Unité populaire. En dépit de contradictions internes et de pressions immenses, une tentative originale de transition vers le socialisme démocratique s’est déployée entre 1970 et 1973.
Fabien Escalona et Romaric Godin
11 septembre 2023 à 12h16
IlIl y a cinquante ans au Chili, le coup d’État militaire contre le gouvernement d’union de la gauche et le président Salvador Allende a imprimé des images choquantes : celles du palais de la Moneda en flammes, et des fusils pointés contre des prisonniers politiques, détenus et torturés dans le stade national.
Le 11 septembre 1973 est cependant l’issue, tragique, d’un processus à la fois plus lumineux et contradictoire, qui a charrié des énergies et des espoirs populaires à un niveau d’intensité rare dans l’histoire. Il s’agit des trois années durant lesquelles les forces de l’Unité populaire (UP), qui soutenaient Allende à l’élection présidentielle de 1970, ont tenté d’engager une transformation sociale d’envergure, avec le socialisme pour horizon.
Avec 36,6 % des voix recueillies lors de ce scrutin, auquel il participait pour la quatrième fois, Allende ne disposait pas de la majorité absolue qui lui aurait permis d’être élu directement président de la République. Selon la Constitution en vigueur, les élus du Congrès chilien ont alors arbitré entre lui et le candidat de la droite conservatrice, Jorge Alessandri, qui le talonnait avec 35,3 % des suffrages. Allende a donc dû son élection à un pacte avec la démocratie chrétienne, qui constituait alors le pôle central de la vie politique chilienne.

Ces conditions d’arrivée au pouvoir ont fortement pesé sur le destin de l’Unité populaire. Elles ont accru la fragilité d’une construction politique en proie à l’hostilité immédiate des États-Unis, qui traquaient tout risque de contagion « collectiviste » dans leur arrière-cour, et aux résistances des classes dominantes de la société chilienne. Ces obstacles ont en même temps concouru à l’émergence d’initiatives populaires autonomes remarquables, cherchant à défendre les acquis et les promesses de l’expérience en cours.
C’est précisément cette quête d’émancipation qu’a explorée Franck Gaudichaud, professeur en histoire et études latino-américaines contemporaines à l’université de Toulouse, dans l’ouvrage issu de sa thèse, Chili 1970-1973. Mille jours qui ébranlèrent le monde (PUR, 2013), et dans un ouvrage pédagogique publié ce mois-ci, Découvrir la révolution chilienne (Éditions sociales, 2023).
Mediapart : Salvador Allende a conquis la présidence du Chili grâce à une union des gauches, l’Unité populaire (UP). Quelles en étaient les composantes, et comment Allende se situait-il par rapport à ces dernières ?
Franck Gaudichaud : Il est en effet important de préciser que sans union de la gauche, il n’y avait pas de victoire. L’union a été la grande obsession militante d’Allende depuis les années 1930. Marqué par l’expérience du Front populaire de 1938, il estimait que seule l’union du PS et du PC chiliens donnerait accès à l’exécutif. Il a parfois tenu cette position dans l’adversité, comme lorsqu’il a rompu avec son propre parti, le PS, lors de la phase anticommuniste de ce dernier.
L’Unité populaire est née à la suite de plusieurs expériences unitaires entre la fin des années 1930 et 1969, lorsqu’elle a été constituée pour les élections législatives, puis reconduite pour l’élection présidentielle de 1970.
La spécificité de l’UP était d’être marquée par un contexte de forte polarisation sociale, ce qui se repère dans la radicalisation du discours et du programme des partis de gauche. L’hégémonie y était exercée par les socialistes et les communistes, soit une alliance de marxistes anti-impérialistes, qui comptaient parmi leurs alliés secondaires des composantes du vieux parti radical, ainsi que des chrétiens de gauche issus de la démocratie chrétienne, nouveau pilier du système politique depuis les années 1950.
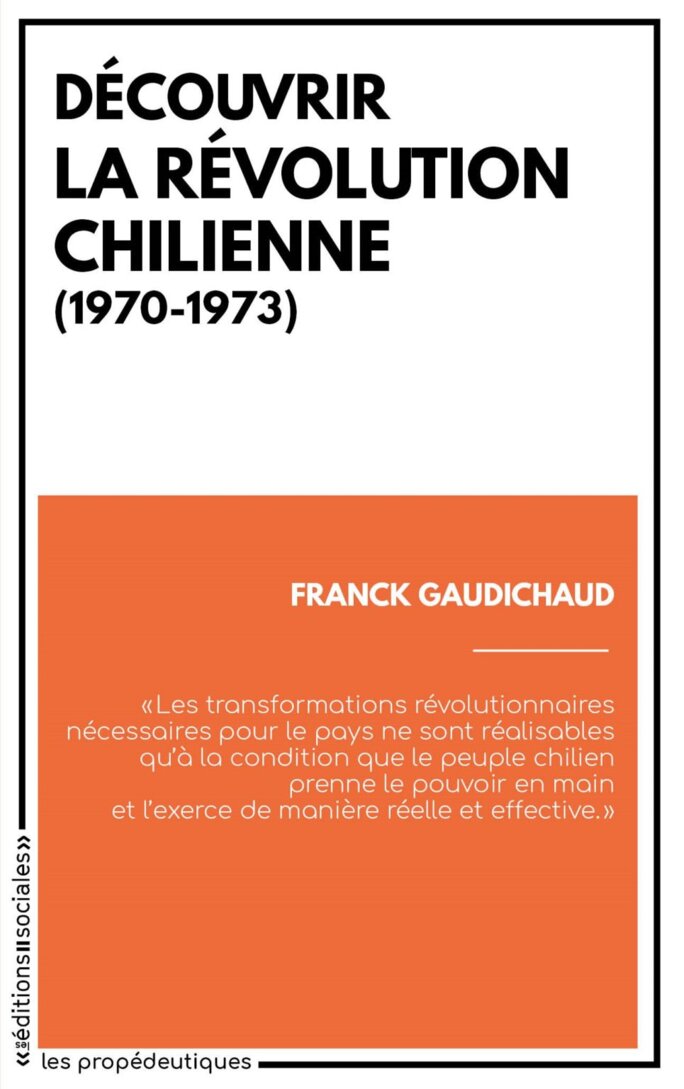
© Éditions sociales
À vous lire, on comprend que cette victoire a été acquise à travers une impressionnante mobilisation de terrain, dans laquelle la dimension culturelle était importante. Un univers qui paraît très lointain…
Il est clair que, politiquement, le Chili d’aujourd’hui est un autre pays. À l’époque de l’Unité populaire, il existait des grands partis de masse insérés dans la classe ouvrière. Pour 9 millions d’habitants, le PC comptait 160 000 militants chevronnés, le PS 140 000, auxquels il faut ajouter des centaines de milliers de personnes, qui participaient à l’agitation à la base.
Lors de la campagne électorale, des dizaines de milliers de comités de l’UP ont été constitués – certains ayant d’ailleurs regretté, plus tard, qu’ils aient été délaissés par le nouveau pouvoir. Allende est allé de village en village par le train, pour de la propagande électorale mais aussi de l’action culturelle. L’UP bénéficiait en effet d’une surface de soutien importante parmi les artistes, à l’heure où émergeait une « nouvelle chanson chilienne », qui se plaçait explicitement dans une perspective socialiste.
Allende parvient à la présidence sans majorité absolue des voix, grâce à un accord avec la démocratie chrétienne. En quoi cela a-t-il posé problème par la suite ?
L’explosion de joie suscitée par la victoire d’Allende a été limitée d’emblée. Car le programme de l’UP, c’était une transition légale au socialisme, qui respectait l’ordre constitutionnel. Être minoritaire, dans le corps électoral et dans les institutions, était dès lors un problème central. La négociation avec le pôle central de la démocratie chrétienne était incontournable, sauf qu’après avoir été dominée par son aile gauche, cette force a basculé vers la droite.
Aux États-Unis, le pouvoir avait bien conscience de cette fragilité. Allende n’était même pas entré à la Moneda qu’ils ont cherché à l’exploiter pour empêcher son arrivée au pouvoir, puis pour le déstabiliser.
Quel genre de socialisme promettait l’Unité populaire ?
Dans le contexte de la guerre froide, dans un petit pays d’Amérique latine, il s’agissait d’une proposition originale. Il ne s’agissait pas d’un alignement sur l’URSS, la voie armée était rejetée, mais la proposition allait plus loin qu’une social-démocratie radicalisée. On peut dire que l’UP portait un programme de souveraineté « nationale-populaire », en revendiquant un horizon socialiste. Derrière, il y avait la conviction que l’État était « flexible », assez en tout cas pour que s’y déploie un agenda de démocratisation avancée, qui concerne jusqu’à la propriété des moyens de production.
Y avait-il une homogénéité de vues sur cet « horizon socialiste », et sur la manière de l’atteindre ?
Le programme ne donnait pas de détails. Et de fait, des conflits importants vont s’envenimer au fil de l’expérience de l’UP, notamment entre les économistes communistes, soucieux de procéder par étapes, en négociant avec le patronat et la démocratie chrétienne, et ceux liés à l’aile gauche du PS, qui pensaient qu’il fallait procéder de manière massive et rapide. Les désaccords vont notamment se cristalliser sur le nombre d’entreprises nationalisées.
Car une stratégie générale commune est tout de même décelable. Il s’agissait d’être en mesure de piloter une grande partie de l’économie, en prenant le contrôle des secteurs dits « monopolistes ». Cela concernait le système bancaire allouant le crédit (90 % de ce secteur seront nationalisés), ainsi que des grandes entreprises jugées essentielles, en particulier les grandes mines de cuivre (elles aussi seront nationalisées, à l’unanimité des parlementaires dans la mesure où même la droite réactionnaire n’osera pas s’opposer frontalement à la mesure).
Il faut ajouter à cela une réforme agraire considérable, mise en œuvre entre 1971 et 1972. C’est une des plus radicales qui ont été accomplies au XXe siècle en Amérique latine. À l’issue du processus, la grande propriété foncière a été pour ainsi dire liquidée. Enfin, un grand projet de planification était prévu, dénommé Cybersyn, consistant à suivre les évolutions économiques en temps réel, qui n’a pas pu être mené jusqu’au bout.
La gauche chilienne était consciente des résistances à attendre de la bourgeoisie.
Ce cap général souffrait de plusieurs contradictions. Le secteur de la distribution est ainsi resté un angle mort de la politique de l’UP, alors qu’il était contrôlé à hauteur de 70 % par des propriétaires privés. De gros lobbies commerçants ont eu les moyens de provoquer des goulets d’étranglement. De plus, l’augmentation des salaires sans augmentation de la production dans les mêmes proportions a alimenté une inflation des prix, à laquelle s’est ajoutée une inflation « politique », suscitée par le boycott international de certaines marchandises, ou la fermeture du crédit à l’État chilien.
De quelle manière les résistances ont-elles été anticipées ?
La gauche chilienne était consciente des résistances à attendre de la bourgeoisie. Le comité national de l’UP, incluant les dirigeants de toutes ses composantes, avait identifié dès le départ des obstacles internes et externes à la réalisation du projet.
Il y avait l’idée que la transition vers le socialisme resterait possible grâce à la pression populaire, notamment via le syndicat unique des travailleurs, la CUT. Le pari consistait à contraindre la bourgeoise industrielle, commerçante et extractive, à vendre ses actifs plutôt que de risquer de les perdre.
Cette conscience des résistances n’empêchait pas cependant la diversité des analyses tactiques. Il existait une tension très forte entre, d’un côté, un pôle conciliateur, incarné principalement par le PC, qui souhaitait négocier étape après étape, avec l’idée de « consolider pour avancer », sans multiplier les fronts d’adversaires ; et de l’autre côté, un pôle « rupturiste », bien représenté par l’aile gauche du PS et le Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR), qui affirmait qu’il fallait avancer sans transiger, pour ne pas laisser les adversaires s’organiser.
Cette tension a été aiguisée par l’explosion des pénuries et du marché noir, qui ont exaspéré les classes moyennes les plus susceptibles de basculer dans le camp adverse de l’UP. En plus des résistances internes, on peut objectivement parler d’une conspiration internationale pour « faire crier l’économie », selon l’expression du président américain Nixon, qui en a fait un objectif. Les États-Unis sont en effet intervenus pour bloquer l’accès du pays au crédit international, l’empêcher de se fournir en pièces de rechange, réquisitionner les exportations qui lui auraient permis de se procurer des devises, etc.
Un des points centraux de vos travaux concerne le « pouvoir populaire » qui va se mettre en place en octobre 1972 et qui est aussi une des originalités de ce processus chilien. Quelles sont ses origines et ses formes ?
Au printemps 1971, la coalition d’Unité populaire obtient 50 % des voix. L’opposition s’inquiète de cette progression électorale et craint une dissolution du Congrès, voire la convocation d’une assemblée constituante. Après un débat intense, Allende décide de ne pas dissoudre, ce qui a peut-être été une occasion manquée. Car, en face, le camp de l’opposition radicale comprend qu’il lui faut s’unifier en faisant basculer la démocratie chrétienne de son côté, et en frappant la gauche là où ça fait mal, sur l’économie.
Le pays a alors été frappé par une grève des camionneurs, avec l’appui de la CIA qui doublait les salaires des grévistes, et un blocage général de l’économie par les professions libérales et les grandes fédérations du commerce et de l’industrie. C’est ce qui a suscité une réponse « par en bas », avec des formes d’auto-organisation populaire qui ont été définies par le MIR, mais pas seulement, comme un « pouvoir populaire ».

Cette réponse a été un moment fort de la révolution chilienne, et la raison pour laquelle j’utilise ce terme dans le titre de mon livre. Longtemps, une partie de l’extrême gauche a refusé l’emploi du mot « révolution » pour le Chili d’Allende, parce qu’il n’y a pas eu de « rupture de l’État bourgeois ». Mais aujourd’hui, je considère qu’on a bien eu affaire à une expérience révolutionnaire en raison de son niveau d’organisation, de la remise en cause de la production et des relations de genre, et de l’action culturelle qui s’est déployée.
Une dimension importante de cette expérience a été l’existence des « cordons industriels »…
Oui. Dans les périphéries des grandes villes, des coordinations territoriales syndicales se sont mises en place. Il ne s’agissait pas de « soviets à la chilienne », mais de formes d’auto-organisation avancées. Elles ont commencé par des occupations d’usines ou de terrains, mais on a pu aussi voir des formes embryonnaires de pouvoir ouvrier durant plusieurs jours, avec des assemblées qui ont débordé les structures syndicales.
Ce qui est intéressant, c’est que ces débordements ont sauvé Allende pendant un temps. Il y avait là une relation dialectique, que Daniel Bensaïd a appelée une « respiration saccadée ». Il n’existait pas de séparation entre le mouvement social et le pouvoir politique. Allende, jusqu’au bout, est resté le président d’une grande partie du mouvement ouvrier, même en étant sous le feu des critiques.
Ce fut notamment le cas quand il a choisi de faire entrer des militaires au gouvernement, ou de déclarer l’état de siège en confiant le contrôle des voies publiques aux généraux, ou encore quand il a choisi de restituer des entreprises occupées. À partir de 1973, le PC et les militaires ont en effet clairement pris la main, et voulu rendre des entreprises dans l’espoir de négocier avec la démocratie chrétienne.
Ces formes d’auto-organisation ont donc été regardées avec méfiance par un gouvernement qui refusait de s’appuyer sur elles. Dans le cadre d’une révolution qui se veut légale, ces organisations représentaient aussi un danger pour Allende et le PC. N’y a-t-il pas ici une vraie contradiction du chemin chilien vers le socialisme ?
Oui, il s’est enclenché une dynamique de polarisation alimentée par les militants de l’Unité populaire, surtout du PS, et par certaines forces extraparlementaires comme le MIR, mais qui n’est pas allée jusqu’à la rupture avec le gouvernement. En revanche, Allende a condamné à plusieurs reprises les occupations d’usines ou l’action des cordons industriels. Le PC voulait intégrer ces cordons industriels à la CUT, donc les cantonner à un rôle syndical, alors qu’ils jouaient un rôle très différent. Ce parti a condamné ces mouvements en leur reprochant de faire le jeu de la droite et de l’impérialisme et de ne pas respecter les engagements de l’Unité populaire.
On a une défaite stratégique de la voie légale mais, en face, l’option du pouvoir populaire et de la rupture n’était pas en capacité d’offrir une alternative concrète.
Le gouvernement est devenu une sorte d’arbitre entre ces deux pôles, et Allende a choisi le camp du PC et de la négociation. On se souvient de cette scène où une ministre du travail communiste a giflé un syndicaliste membre d’un cordon industriel, en le traitant de provocateur et de gauchiste.
On aurait deux logiques qui s’entretiendraient l’une et l’autre tout en s’opposant, mais sans qu’aucune n’ait les moyens d’aller au bout. Le gouvernement était coincé dans sa logique légaliste, et le pouvoir populaire ne pouvait prétendre se substituer à lui. Cela a-t-il rendu toute l’expérience vulnérable ?
Dans ma thèse, j’ai parlé d’une dualisation de pouvoir qui n’aboutissait pas. On voit bien que les deux pôles prennent des chemins différents, entre l’organisation par le bas et la logique institutionnelle. Même si ce n’est pas si clair, puisque le gouvernement va organiser des comités de ravitaillement et de contrôle des prix par les habitants. Mais il est vrai que ces comités restaient contrôlés par les autorités…
Dans ce processus complexe, on constate une « double incapacité ». On a une défaite stratégique de la voie légale mais, en face, l’option du pouvoir populaire et de la rupture n’était pas en capacité d’offrir une alternative concrète.
Le MIR, l’aile la plus radicale, est née en 1965 et était encore une petite organisation, incapable d’organiser l’alternative. Il a d’ailleurs mal compris la question des cordons industriels, dans la mesure où sa culture guévariste, très verticale et basée sur une logique politico-militaire, n’était pas adaptée à la situation où l’on voyait émerger des noyaux d’auto-organisation. Le MIR était lui aussi en décalage avec la situation révolutionnaire concrète.
Tout se passe donc comme s’il n’y avait pas d’institutions révolutionnaires capables de saisir ce mouvement ?
Il faut toujours être prudent quant à ce qu’il aurait fallu faire. Mais effectivement, les institutions du mouvement révolutionnaire au sens large ont été en incapacité de proposer une issue. Alors que chacun savait que le coup d’État allait avoir lieu. On constate une sorte de paralysie pour affronter le contexte.
C’est pourquoi j’avais utilisé la distinction de Charles Tilly dans son Histoire des révolutions en Europe [Les Révolutions européennes, 1492-1992 – ndlr], entre « situation révolutionnaire » et « résultat révolutionnaire ». On a, selon moi, dans le Chili de 1970-73, une situation révolutionnaire qui va jusqu’à remettre en cause la propriété privée, malgré Allende. Le nombre d’entreprises qui ont été « intervenues » ou nationalisées a dépassé les trois cents, bien plus que ce que voulait faire le gouvernement, sous la pression du mouvement ouvrier. Mais on n’a pas eu de résultat révolutionnaire.
Les militaires sont régulièrement intervenus dans l’histoire chilienne au moyen de répressions sévères. Mais la gauche ne voulait pas le voir.
Au milieu de tout cela, le président Allende semble être une figure ambivalente…
Le personnage d’Allende est complexe et intéressant. C’est un parlementaire socialiste, légaliste, qui se dit aussi marxiste, anti-impérialiste et admirateur de Cuba. C’est une figure hybride. Mais il reste persuadé de sa capacité à négocier en permanence tout en radicalisant la démocratie chilienne.
Sur le plan international, il se présente comme un leader tiers-mondiste, anticolonialiste, qui soutient le Vietnam. Il est assez radical. Mais sur le plan interne, c’est un réformiste qui revendique une perspective révolutionnaire.
N’a-t-il pas surestimé le mythe de « l’exception chilienne » qui considère que l’armée n’est pas politisée et que la tradition démocratique est très solide ?
Oui, mais ce mythe était très fort au sein de toute la gauche. Il reposait sur l’idée que le pays avait des institutions plus stables qu’ailleurs, avec seulement deux Constitutions depuis l’indépendance et pas de coups d’État formels, ce qui avait permis des compromis sociaux. En réalité, les militaires sont régulièrement intervenus dans l’histoire chilienne au moyen de répressions sévères. Mais la gauche ne voulait pas le voir. Elle était dominée par l’idée du constitutionnalisme des forces armées.
À lire aussi Chili : l’espoir déçu de la Constituante
9 novembre 2021
Dès 1974-75, le PC clandestin fera une sorte d’autocritique sur son absence de pensée stratégique sur les forces armées. C’est dans ce cadre qu’Allende pense qu’il va pouvoir éviter la guerre civile, qui menace effectivement, en nommant Pinochet, réputé légaliste, chef des forces armées et en gardant sous la manche l’idée d’une dissolution débouchant sur la convocation d’une constituante. C’est d’ailleurs ce qu’il comptait annoncer le 11 septembre. Et cela a conduit les militaires à avancer le coup d’État, initialement prévu le jour de la fête nationale, à ce jour-là.
Fabien Escalona et Romaric Godin
Franck Gaudichaud présentera son livre mercredi 13 à la bibliothèque Mably à Bordeaux


