L’avocat pénaliste navigue de la défense d’activistes à celle de personnes accusées de terrorisme. Ardent défenseur des libertés publiques, il n’a de cesse de dénoncer la résurgence des lois « scélérates »dans notre droit moderne, mêlant justice et politique.
Nadia Sweeny • 11 janvier
Article paru
dans l’hebdo N° 1740

© Maxime Sirvins
Né en 1984, Raphaël Kempf est un avocat pénaliste spécialisé dans les affaires de terrorisme et dans la défense d’activistes. Après plusieurs collaborations dans de grands cabinets, comme celui de Marie Dosé, il s’installe à son compte en 2016. Titulaire d’un master en droits de l’homme et d’une licence d’arabe, il a notamment défendu Yassine Atar, frère du commanditaire présumé des attentats du 13 novembre 2015.
La mèche en bataille, le regard fatigué par des journées sans fin, celui qui n’a de cesse de dénoncer la résurgence des lois « scélérates (1) dans notre droit moderne, nous a reçus à son cabinet parisien pour évoquer le rôle central de la justice dans l’organisation d’une répression teintée de politique, à la veille d’un mouvement social qui s’annonce massif.
1
Lois votées en France sous la IIIe République visant à réprimer le mouvement anarchiste.
Dans le titre de votre dernier ouvrage, vous utilisez l’expression « violences judiciaires ». Comment les identifiez-vous ?
Raphaël Kempf : Une violence qui s’articule autour de deux modalités imposées par le pouvoir judiciaire : les contraintes sur les corps et l’humiliation. Les contraintes sont les mesures de garde à vue, la prison, l’interdiction de manifester, de se rendre à tel endroit, l’obligation de pointer au commissariat, etc. Elles peuvent être ressenties par les personnes qui les subissent comme de la violence. Celle-ci peut apparaître légitime et/ou légale, mais dans certaines situations elle est contestable et contestée.
L’humiliation résulte quant à elle des propos de magistrats, de leur mépris, par exemple quand ils critiquent les choix de gilets jaunes de venir manifester à Paris ou, comme j’ai pu l’entendre lors d’une audience, quand un procureur parle d’antisémitisme alors que les prévenus n’étaient évidemment pas poursuivis pour cela.
L’humiliation se trouve aussi dans le traitement des personnes : quand, dans l’attente d’un procès, on empêche un individu de manifester, on touche à un aspect constitutif de son identité, de sa volonté de s’engager dans l’espace public, la société, la cité.
Cette violence s’exerce principalement avant le jugement ?
La violence de la justice s’applique souvent avant qu’on ait mis un pied dans un tribunal. Lorsqu’on est interpellé par la police en amont d’une manifestation, c’est fréquemment sur la base d’une réquisition : document signé par le procureur de la République autorisant les forces de l’ordre à fouiller sacs et véhicules, indépendamment du comportement individuel des personnes. Or, normalement, un contrôle a lieu lorsque est constatée la commission d’une infraction.
La violence de la justice s’applique souvent avant qu’on ait mis un pied dans un tribunal.
Ce sont ces mêmes réquisitions qui permettent de faire la chasse aux sans-papiers sur la base de contrôles au faciès, discriminatoires et racistes. Les pratiques policières sont autorisées et validées par l’autorité judiciaire, censée être gardienne des libertés individuelles. Parler de violence judiciaire, c’est donc déplacer la focale pour montrer où se trouvent les responsabilités.
En d’autres termes, il existe une sorte de connivence police-justice dans la répression, là où il devrait y avoir un rapport de force équilibré entre les deux parties ?
Je vais prendre un exemple. En décembre 2018, trois gilets jaunes ont été interpellés vers 6 heures du matin au péage de Lisieux. Dans leur véhicule, les gendarmes ont trouvé des ballons de baudruche, des lunettes de piscine, de l’outillage, etc. Ils ont été placés en garde à vue.
Trois acteurs ont rendu cela possible : la ministre de la Justice, Nicole Belloubet à l’époque, qui donne l’ordre aux procureurs de prendre des réquisitions pour permettre des contrôles en vue des manifestations, et un commandant de gendarmerie qui demande par écrit au procureur de Lisieux une réquisition pour contrôler toutes les voitures passant au péage.
La conjonction de ces acteurs aboutit à ce que le contrôle en amont de personnes qui souhaitent exercer leur droit fondamental de manifester se fasse dans les apparences de la légalité et du respect de la loi. Six mois plus tard, les trois gilets jaunes ont été mis hors de cause.
Vous évoquez un double mouvement de dépolitisation et de criminalisation des actions politiques. Quel est-il ?
Cette idée m’a été soufflée par les analyses de Vanessa Codaccioni, sociologue spécialisée dans la justice d’exception. La dépolitisation de l’action politique s’exprime d’abord dans les propos tenus en audience. Des procureurs expliquent à des manifestants qu’ils ne sont que des délinquants, faisant le choix de ne pas voir les raisons politiques de l’action. Cette volonté de dépolitisation se voit aussi dans les motifs de poursuites, par exemple le choix entre « attroupement » et « groupement ». L’un étant politique, l’autre non.
L’attroupement est un rassemblement de personnes susceptible de troubler l’ordre public. Une infraction peut alors être commise si les policiers font des sommations et que les personnes ne les respectent pas. Ce délit est considéré comme politique depuis le XIXe siècle. Dans la tradition du droit français, la justice accorde un traitement de faveur aux personnes accusées de crimes ou de délits de nature politique et, notamment, l’impossibilité d’être jugé en comparution immédiate.
Par conséquent, cette infraction était très peu utilisée par les procureurs jusqu’en 2019. La loi dite « anticasseurs » a supprimé le traitement de faveur accordé au délit d’attroupement, qui peut désormais être jugé en comparution immédiate. La mécanique de dépolitisation passe donc aussi par la loi.
Les procureurs se croient impartiaux alors que leurs choix sont politiques.
Mais les procureurs poursuivent beaucoup les manifestants pour « groupement formé en vue de la préparation de violences ». Avec un collectif d’avocats, nous avons tenté de démontrer que ce délit était politique, parce qu’il venait punir des manifestants dans un contexte de répression des mouvements sociaux. Les juges nous ont donné tort, arguant de l’existence d’une liste d’infractions politiques reconnues par la jurisprudence dont le groupement ne fait pas partie.
Pourquoi ?
L’infraction de groupement est censée prévenir l’acte violent et, dans l’esprit des magistrats, la violence ne peut pas être politique. Cela dit, il y a clairement un argument d’opportunité : si cette infraction devenait politique, les parquets ne pourraient plus utiliser les comparutions immédiates pour la réprimer, ce qui leur ôterait un outil répressif considérable.
Qu’en est-il de la mécanique de criminalisation ?
C’est l’autre mouvement qui agit en parallèle : l’utilisation et parfois le détournement des outils de la loi et de la procédure pénale pour réprimer des personnes qui font le choix d’agir politiquement. Dans les manifestations, c’est massif : lorsque des milliers de gens sont placés en garde à vue et qu’une faible partie est effectivement condamnée, on peut en déduire que la garde à vue ne sert plus à caractériser les éléments d’une infraction pénale mais à maintenir l’ordre en écartant des gens de la manifestation.
Il s’agit délibérément de casser une mobilisation ?
Cette intention peut exister au niveau gouvernemental : les responsables politiques expriment, à travers des circulaires et des prises de parole, le choix d’utiliser les outils de la loi pénale pour réprimer des manifestants. Mais, au niveau de l’institution judiciaire, je l’ignore : ces choix ne sont pas verbalisés et c’est problématique.
Les magistrats ont coutume de dire que la politique doit rester aux portes de l’audience. Qu’en pensez-vous ?
Quand quelqu’un est accusé de violences pour la défense des jardins d’Aubervilliers, rasés pour construire une piscine olympique et un solarium, ou quand des gilets jaunes enfoncent la porte d’un ministère, c’est éminemment politique. Si la justice prétend bien juger, elle ne peut pas faire l’économie de comprendre pourquoi les gens font ce qu’ils font. La politique est dans les prétoires et y a toujours été.
Vous allez jusqu’à affirmer que la justice est politique mais qu’elle ne l’assume pas…
Le ministère public est politique : il n’est pas une institution indépendante. Étonnamment, les procureurs prétendent être impartiaux alors que leurs choix sont profondément politiques : ils appliquent ce qu’on appelle une politique pénale – des choix d’actions et de priorités sur diverses thématiques comme la drogue, les violences sexuelles, conjugales, etc. – qui engage la société tout entière. Or elle n’est ni rendue publique ni discutée collectivement. Cela pose une vraie difficulté.
Un peu comme la décision du parquet antiterroriste de se saisir ou pas ? C’est une question qui est revenue dans le débat public après l’attaque meurtrière raciste contre la communauté kurde à Paris…
De mon point de vue, il ne devrait pas exister de législation antiterroriste. Le droit commun suffit.
On ne connaît pas les critères que le Parquet national antiterroriste (Pnat) a définis pour déterminer ce qui doit être qualifié de terrorisme. Pourtant, on trouve des traces de l’existence de ces directives dans des interviews accordées par des membres du Pnat à des revues spécialisées, mais sans les donner ni les justifier. Or ce sont des choix politiques qui ont des répercussions immenses : l’antiterrorisme est une machine de guerre.
Dans la loi française, des infractions sont considérées comme terroristes lorsqu’elles ont « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Que pensez-vous de cette définition ?
L’infraction terroriste a été créée en 1986 de manière suffisamment vaste pour se saisir d’un grand nombre de comportements avec un argument massue : tout le monde sait ce qu’est le terrorisme, pas besoin de le définir. En réalité, l’imprécision de sa définition est une arme qui permet au gouvernement de qualifier, selon son bon vouloir, des adversaires désignés comme terroristes. De mon point de vue, il ne devrait pas exister de législation antiterroriste car le droit commun permet déjà de punir toutes les infractions reprochées aux « terroristes ».

Quatre grévistes de la CGT ont été placés 96 heures en garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), un traitement usuellement utilisé en matière de terrorisme. Gérald Darmanin a qualifié d’« écoterrorisme » les mobilisations contre les mégabassines dans les Deux-Sèvres (2). Constatez-vous un glissement qui consiste à suspecter toute action politique contestataire de terrorisme ?
2
Raphaël Kempf a cosigné la tribune « Écoterrorisme : les luttes écologistes dans le viseur du ministère de l’Intérieur ? », publiée par différents médias.
Dans l’état actuel du droit pénal, certains mouvements politiques sont effectivement taxés de terrorisme : l’affaire de Tarnac, où des militants désignés d’« ultragauche » ont été considérés pendant dix ans comme terroristes avant de ne plus l’être ; certaines personnes parties combattre avec les Kurdes contre Daech ou des activistes kurdes en France sont aussi considérés comme des terroristes.
Il y a par ailleurs un volet administratif qui consiste à utiliser des mesures de lutte contre le terrorisme pour viser des activistes. On l’a vu contre des militants écologistes. Je le vois contre les Kurdes : depuis deux ou trois ans, le gouvernement gèle des avoirs de réfugiés sous prétexte qu’ils participent aux activités d’associations culturelles considérées comme des émanations du PKK.
On voit aussi dans des dossiers de droit commun la saisine de services de police antiterroriste malgré l’absence de cette qualification juridique. Ces services enquêtent ainsi avec leurs biais habituels, c’est-à-dire : chercher l’idéologie, les convictions de la personne, ce qu’elle pense de la société, de la France, de l’écologie, etc.
Je qualifie la DGSI de police politique car je constate que les questions posées en garde à vue par ses agents portent sur les opinions, les lectures, les centres d’intérêt ou la conception du monde qu’ont les personnes. Tous ces éléments deviennent des arguments légaux et juridiques.
Faire bouger les lignes sociales implique de ne pas respecter certaines normes.
La désobéissance civile est-elle, selon vous, un mode d’action légitime ?
Si cela consiste à ne pas respecter certaines lois dans le but d’affirmer quelque chose politiquement, c’est une voie d’action parfois nécessaire. Faire bouger les lignes sociales implique de ne pas respecter certaines normes.
Pourtant on constate que perturber « l’ordre public » déclenche des cris d’orfraie…
La démocratie passe aussi par des formes d’atteinte à l’ordre normal des choses. Une manifestation a pour objet d’empêcher la circulation, ou une grève d’entraver le fonctionnement normal d’une activité. Si on pense une démocratie dans laquelle rien ne bouge et rien ne peut jamais être interrompu, alors ce n’est pas une démocratie dans laquelle des libertés peuvent s’exercer.
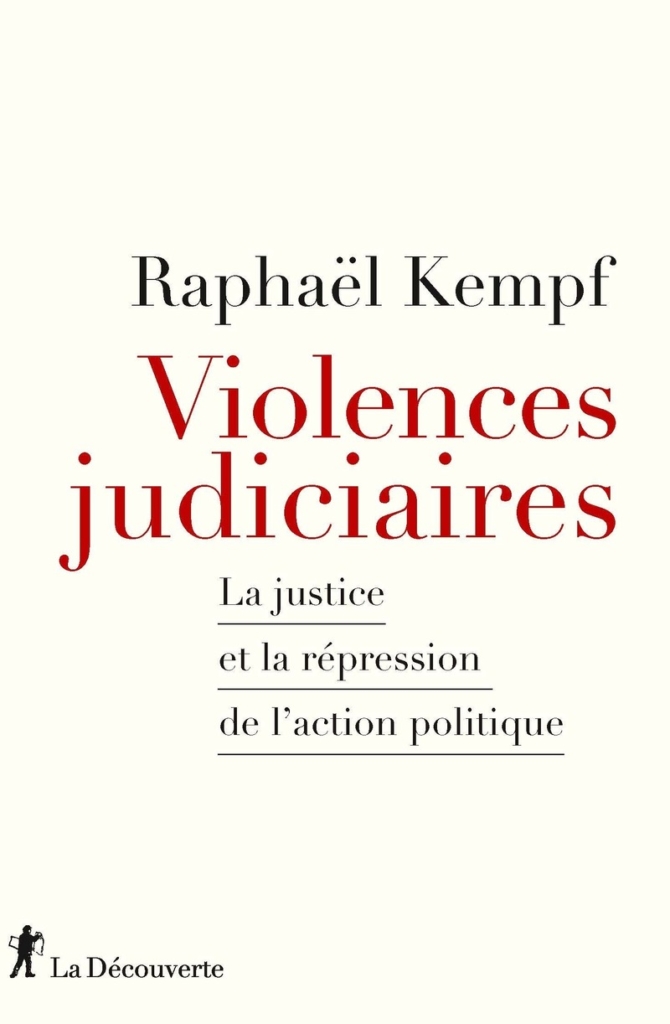
Pour la droite, il conviendrait de supprimer des droits pour protéger la population, car trop de droits humains rendraient la justice faible et laxiste. Quel argument leur opposez-vous ?
Je leur dis : vous aussi, vous pouvez être arrêté demain ! Ça peut arriver à n’importe qui assez facilement. À ce moment-là, vous vous rendez compte à quel point ces droits sont essentiels. Quand on parle de droits humains, il s’agit du droit de voir un médecin, son avocat, de prévenir sa famille, de savoir de quoi on est accusé, d’avoir accès à son dossier, de ne pas être envoyé en prison n’importe comment et sans raison… Ça n’est pas abstrait.
D’autre part, la justice n’est pas laxiste : il n’y a jamais eu autant de prisonniers dans ce pays et le taux de réponse pénale est extrêmement élevé. La droite pense que le recours à l’incarcération fait baisser le nombre de crimes et de délits, or la prison n’a pas démontré son efficacité, bien au contraire.

Toutes ces croyances découlent d’un populisme pénal et de l’idéologie de la « tolérance zéro ». Quand j’ai commencé mes études de droit, dans les années 2000, de grandes voix dénonçaient le populisme pénal et je ne pensais pas vivre une telle régression.
Le combat pour les libertés individuelles est un échec depuis vingt ans.
Aujourd’hui, nous avons vu notamment le passage de l’état d’urgence dans le droit commun et de nombreuses lois liberticides donnant toujours plus de pouvoirs aux parquets et aux forces de l’ordre. Je constate que le combat pour les libertés individuelles est un échec depuis vingt ans.
À la veille d’un possible mouvement social d’ampleur, quels conseils donneriez-vous aux manifestants confrontés à la répression ?
Désignez un avocat, prévenez un proche et, surtout, gardez le silence en garde à vue !
Les livres de Raphaël Kempf
– Ennemis d’État, La Fabrique, 2019.
– Violences judiciaires, La Découverte, 2022.


