Le sociologue François Héran pense que certains défenseurs de l’universalisme républicain occultent l’ampleur des discriminations ethno-raciales et religieuses.
Propos recueillis par Anne Chemin

Élu en 2017 professeur au Collège de France sur la chaire « Migrations et sociétés », François Héran dirige l’Institut Convergences Migrations après avoir présidé aux destinées de l’Institut national d’études démographiques pendant plus de dix ans. Dans un texte écrit après l’assassinat de Samuel Paty, Lettre aux professeurs sur la liberté d’expression (La Découverte, 252 pages, 14 euros), le sociologue et démographe plaide en faveur d’une République qui sache faire vivre la « règle d’or du respect mutuel ».
Dans une démocratie libérale, écrivez-vous, la liberté d’expression et la liberté de conscience forment un « couple inséparable ». Comment se conjuguent-elles, en France, depuis 1789 ?
La liberté d’expression tend aujourd’hui à étouffer ou absorber la liberté de croyance alors que, historiquement, ce sont des tours jumelles. Dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, elles sont consacrées, l’une après l’autre, par des articles qui posent le principe de la liberté avant de rappeler qu’elle s’exerce dans les limites de la loi. A charge pour le législateur ou la justice de veiller à ce que ces limitations ne soient pas liberticides.
Mais rien n’est dit sur la façon d’articuler liberté d’expression et liberté de croyance, sans oublier le lien avec les libertés connexes : droit d’association, dignité des personnes, respect des droits d’autrui. La dure tâche de « mettre en balance » les libertés revient donc à la justice nationale et européenne. Or c’est un principe majeur parfois oublié en France : les libertés fondamentales sont « indivisibles », on ne peut pas jouir de l’une en écartant les autres. La Convention européenne n’est pas un Mikado dont on pourrait retirer une poutre à sa guise, c’est un édifice cohérent.
Vous regrettez que, avec les débats sur les caricatures de Mahomet, la liberté d’expression ait aujourd’hui pris le pas sur la liberté de conscience. Quels sont, selon vous, les dangers de cette évolution ?
Rien n’est sacré pour la caricature : c’est dans notre tradition. Mais, depuis les attentats
djihadistes, on sacralise la désacralisation en paralysant toute critique des caricatures. C’est un recul pour la liberté de conscience, mais aussi pour la liberté d’expression. C’est pourquoi je reprends, dans mon livre, les débats qui ont divisé le milieu des caricaturistes, dont Pétillon, qui travaillait à la fois au Canard enchaîné et à Charlie Hebdo. Peut-on mettre sur le même plan les caricatures qui ciblent l’extrémisme et celles qui avilissent la pratique des fidèles ? Peut-on exercer sa liberté d’expression en négligeant les niveaux d’expression ?
Ce n’est pas parce que les djihadistes confondent tout que nous devons remiser notre faculté de discernement. La Cour de Strasbourg rappelle que la satire blessante est légitime – à condition qu’elle contribue au débat démocratique. Où est le débat quand la « critique » ne fait qu’avilir la pratique religieuse ordinaire ? C’est le cas, par exemple, d’un dessin de Coco montré furtivement par Samuel Paty à ses élèves de quatrième : le prophète en prière est prosterné nu, vu de dos, une goutte au pénis, une étoile dans l’anus. Conscient du problème, le professeur avait invité les élèves choqués à quitter la salle.
Pour la même raison sans doute, l’association DCL [Dessinez Créez Liberté] créée par Charlie Hebdo s’était abstenue d’inclure cette caricature dans ses dossiers pédagogiques destinés aux élèves. Jean-Michel Blanquer, de son côté, a eu beau proclamer que « la lâcheté n’est plus de mise », il a refusé d’inclure les caricatures de Mahomet dans les manuels scolaires par respect pour la « liberté pédagogique et éditoriale ». C’est dire qu’il y a des limites à la liberté d’expression, même aux yeux de ses plus ardents défenseurs. La charte de la laïcité à l’école et le programme d’éducation morale et civique font d’ailleurs fi de la distinction spécieuse qui voudrait qu’on puisse offenser les croyances sans offenser les croyants : respecter autrui, c’est aussi respecter ses convictions religieuses. Quand on doit initier les élèves aux règles de la vie sociale, force est de revenir à la « règle d’or » qui a inspiré la déclaration de 1789 et les fondateurs de l’école républicaine : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse.
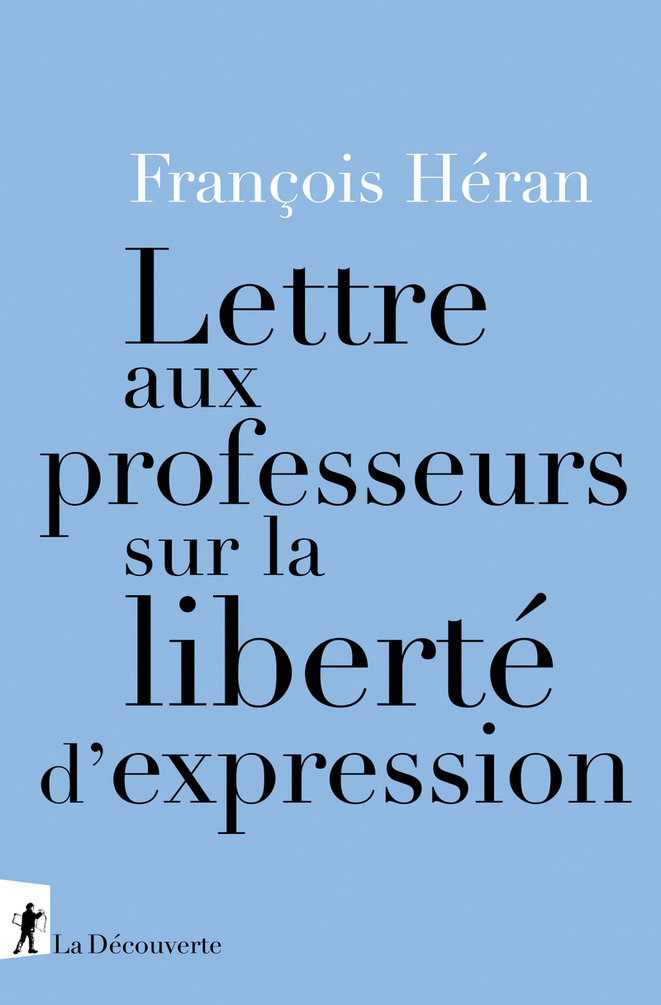
Vous affirmez que l’ampleur des discriminations ethno-raciales en France se heurte à une « culture du déni » qui mine le lien social. Pourquoi ?
Nombre d’enquêtes et de testings attestent l’ampleur des discriminations ethno-raciales en France. Si vos origines maghrébines ou subsahariennes sont perceptibles, vos chances d’obtenir un entretien d’embauche sont, à diplôme égal, divisées par deux ou trois et l’écart s’accroît quand transparaît une appartenance à l’islam. Ce phénomène est passé sous silence par les pamphlets qui accusent les victimes de se complaire dans la victimisation et d’être portées par la « haine des Blancs ». On leur dénie le droit de dénoncer l’islamophobie, pourtant attestée par les données, et l’on décrète que ce mot doit être banni, parce qu’on y voit une offense à l’universalisme républicain. Or l’objectif est tout autre : il s’agit d’identifier les mécanismes qui empêchent la République de tenir ses promesses. Déni des réalités, convictions offensées, recours à la police des mots : on est dans une forme de « cancel culture ».
Pour les défenseurs de l’universalisme républicain, les adeptes des théories « racialistes » ou « identitaires » mettent en péril l’égalité des droits – ils pensent notamment aux réunions non mixtes. Que répondez-vous ?
L’affaire des réunions non mixtes a pris des proportions démesurées. Si des groupes d’étudiantes ou d’étudiants préfèrent discuter en interne de leur expérience des discriminations, c’est parce que la réalité des discriminations est largement niée par le pouvoir exécutif ou législatif. Au lieu de voter des mesures concrètes, on se contente d’incantations sur l’universalisme républicain et le principe d’égalité. Qui s’offusque, par exemple, de l’existence de l’association Femmes de l’intérieur, fondée par les femmes occupant des positions de responsabilité au ministère de l’intérieur ? Le feraient-elles si elles ne devaient pas unir leurs forces contre les obstacles et les préjugés ? Le bulletin d’adhésion porte en petits caractères que les hommes sont bienvenus s’ils partagent les idéaux de l’association mais, de fait, les réunions sont féminines et l’on y traite de sujets comme le harcèlement au travail. Où est le mal ?
L’affaire des réunions « non mixtes » a fait beaucoup de bruit pour rien. Ce n’est pas le rien qui m’inquiète, c’est le bruit – ces réactions en chaîne portées par quelques médias et qui ont fini par emballer le Sénat, tout cela parce qu’il est question de discrimination « raciale ». On peut s’octroyer ainsi, avec un maximum de rhétorique et un minimum d’enquête, un brevet de républicanisme. Eric Zemmour s’est offert le plaisir de railler « cette gauche qui encourage le retour du racisme » mais taxer de racisme ceux qui s’intéressent de trop près aux discriminations raciales, c’est aussi absurde que d’accuser les criminologistes d’être des criminels.
J’attends autre chose du Parlement. A quand la « nuit du 4 août » qui donnerait au Défenseur des droits les moyens de mettre sur pied un observatoire national des discriminations digne de ce nom, capable de mesurer périodiquement leur ampleur, y compris les discriminations indirectes, qui sont les plus fréquentes et brisent des vies par dizaines de milliers ? Les députés socialistes ont rejeté, en 2016, la formule anglaise des récépissés d’interpellation. Les caméras embarquées, expérimentées çà et là, ont été récusées par les syndicats de police, qui ont également vilipendé la « plate-forme de signalement » lancée en février 2021 par Emmanuel Macron.
Après avoir affirmé que les sciences sociales étaient « gangrenées » par l’« islamo-gauchisme », la ministre des universités, Frédérique Vidal, a demandé au CNRS de distinguer les recherches « militantes » des recherches « scientifiques ». Estimez-vous qu’elle met en péril les libertés académiques ?
Il en va des libertés académiques comme de toutes les libertés : elles doivent faire l’objet d’une vigilance interne permanente. Les chercheurs doivent impérativement respecter les contraintes de méthode de chaque discipline. La controverse est cependant inhérente à l’activité scientifique et l’engagement en faveur de causes générales est le ressort de bien des vocations d’enseignants ou de chercheurs. Face à la concurrence, y compris celle des nouvelles générations, certains sont parfois tentés de déplacer le débat scientifique sur le terrain politique, voire judiciaire, en intéressant les médias à leur querelle, mais c’est une infime minorité. Laissons les chercheurs débattre de questions telles que la mesure de l’islamophobie, les études décoloniales, les méthodes intersectionnelles, etc. Rien ne justifie que des ministres interfèrent dans ces débats : ils sortent alors de leur ordre, comme disait Pascal. N’ont-ils pas d’autres affaires à régler ?


