14 mars 2021 Par Joseph Confavreux
Dans son dernier livre, François Héran, professeur au Collège de France, revient sur la séquence ouverte par l’assassinat de Samuel Paty et nous permet, par une démonstration implacable, de nous situer dans des débats inflammables.
«Déshabiller le prophète pour habiller la collégienne », « octobre 2020 : crimes et boniments », « l’insoutenable paradoxe de la liberté obligée »… C’est sur un ton à la fois souriant et apaisé, avec une écriture aussi enlevée que mesurée, que François Héran, professeur au Collège de France, a écrit une Lettre aux professeurs sur la liberté d’expression que viennent de publier les éditions La Découverte.
Le livre est davantage qu’un prolongement éditorial du texte qu’il avait initialement publié sur La Vie des idées quelque temps après l’assassinat de Samuel Paty, décapité par un jeune djihadiste en octobre 2020.
Il constitue en effet, à partir de la tragédie vécue par l’enseignant du collège de Conflans-Sainte-Honorine, une réflexion implacable pour se situer dans les débats inflammables de notre temps : accusation d’islamophobie à l’encontre de deux enseignants de Sciences-Po Grenoble, enquête lancée par la ministre de l’enseignement supérieur sur « l’islamo-gauchisme » dans le monde universitaire, projet de loi « confortant le respect des principes de la République », laïcité à l’école…
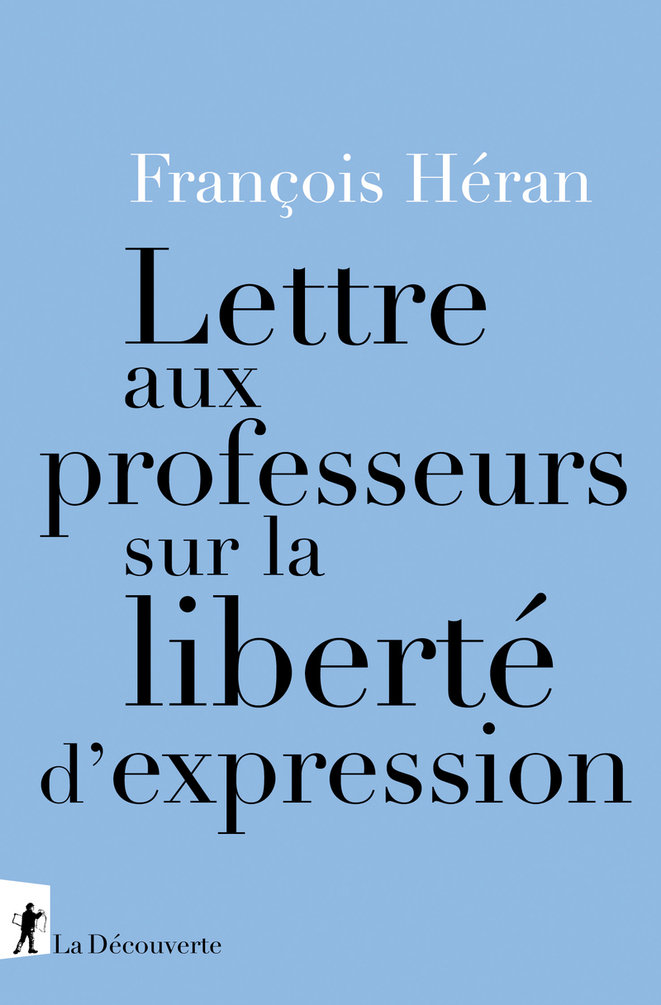
Nourri par une lecture serrée aussi bien de la jurisprudence française et européenne que des différents supports utilisés dans les cours d’éducation morale et civique, l’ouvrage invite à ne pas faire de la liberté d’expression un totem, afin de mieux la défendre ; à ne pas brandir la République comme une arme, pour mieux la faire vivre ; à ne pas être amnésique sur le passé, dans l’idée de se projeter vers un futur pacifié et partagé.
Cette Lettre aux professeurs vise à donner des arguments à des enseignants en première ligne mais s’adresse à un public beaucoup plus large, notamment parce que le chercheur y fait usage autant de son questionnement de sociologue que de son savoir de démographe, sans doute la seule des sciences sociales à posséder quelque valeur prédictive.
On ressort ainsi du livre convaincu non seulement par la rigueur du raisonnement, mais inquiet que les emballements médiatiques à répétition et les postures gouvernementales actuelles s’avèrent aussi éloignés de la réalité telle qu’elle est, mais aussi de la société telle qu’elle se dessine. Entretien.
Que vous inspire la récente polémique sur les professeurs accusés, par voie d’affichage, d’islamophobie, Science-Po Grenoble ?
François Héran : Le sentiment que la police des mots, de quelque bord qu’elle vienne, nous entraîne dans des polémiques dévastatrices. L’enquête publiée le 11 mars par Mediapart a été la première à tenter de confronter les points de vue de tous les protagonistes et à publier les échanges de mails ; c’est très précieux. Au départ, un groupe de travail intitulé « Racisme, islamophobie, antisémitisme » devait préparer la troisième édition de la « Semaine pour l’égalité et contre les discriminations », organisée de concert par le personnel enseignant et les étudiants.
Or l’un des enseignants exige, menace de démission à l’appui, que le mot « islamophobie » disparaisse du titre : c’est, selon lui, une « persécution imaginaire »,une dangereuse formule de « militants » forgée par les islamistes. La directrice de l’institut a beau lui citer des recherches sérieuses qui explorent et mesurent l’islamophobie, il réitère ses arguments dans une série de messages péremptoires, soutenu par un sociologue connu pour ses tribunes sur le sujet. Leurs textes s’inscrivent dans la doxa actuelle : l’islamophobie serait une « arme » des djihadistes, il faut donc l’exclure du débat.
Comment fallait-il réagir, selon vous, à cette volonté d’exclure « l’islamophobie » du débat ?
Certainement pas en placardant des dénonciations nominatives sur la façade de l’institution, et pas davantage en proclamant que « l’islamophobie tue ». Si le blocage du débat en interne a sans doute poussé à de telles extrémités, elles restent condamnables et contre-productives : il suffit de voir comment les médias qui pratiquent le déni sur l’islamophobie se sont emparés du slogan.
Au sein de la société française actuelle, l’islamophobie ne tue pas, elle brise des vies. Il est avéré qu’elle réduit drastiquement les chances d’entrer dans la vie professionnelle à hauteur de ses diplômes.
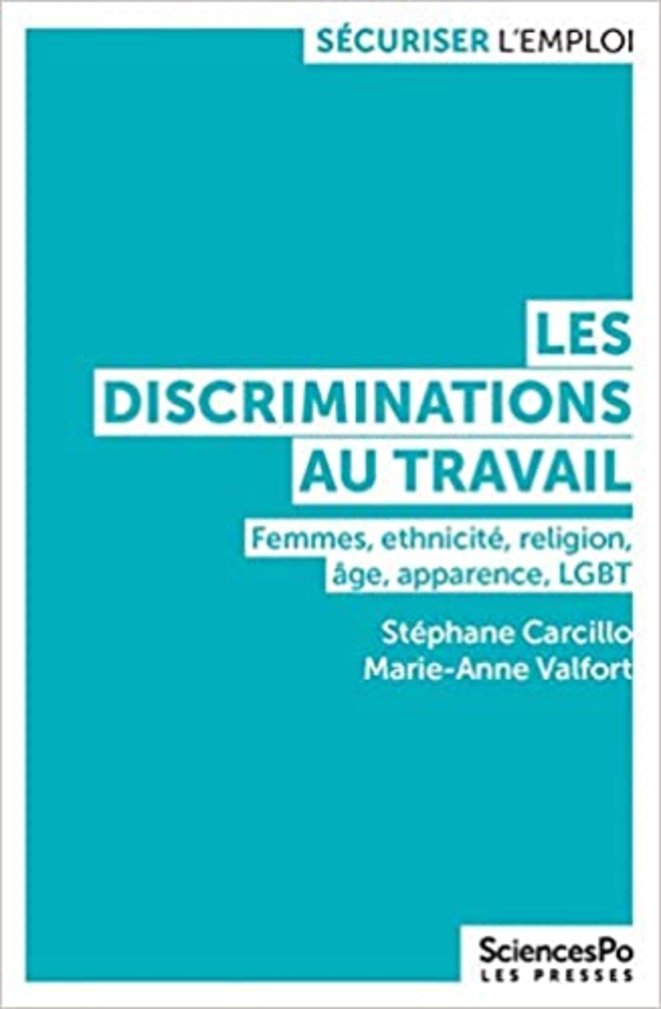
Je cite dans mon livre les résultats du vaste testing mené à ce sujet par l’économiste Marie-Anne Valfort. En 2013-2014, elle a expédié 6 230 CV à des offres d’emploi pour des postes en comptabilité. Les résultats sont accablants. Si le CV laisse transparaître des « signes » de laïcité ou d’appartenance religieuse, les chances d’obtenir un entretien d’embauche, déjà réduites pour les candidatures juives, sont divisées par quatre pour les candidats musulmans – et cela à diplôme égal, en l’occurrence un BTS de comptabilité. Marie-Anne Valfort démontre que la discrimination religieuse ne se confond pas avec la discrimination ethno-raciale : elle s’y ajoute. Ses effets sont massifs.
Pourquoi l’ampleur des discriminations ethno-raciales et religieuses est-elle à ce point méconnue ?
Plusieurs causes y concourent : la faiblesse de la formation statistique en France, l’absence de formation juridique, le désintérêt de la plupart des médias, le mythe d’un État républicain qui serait immunisé d’office contre les discriminations, l’idée reçue que les statistiques sur les origines migratoires et les affiliations religieuses seraient prohibées en France – alors que des dérogations sont possibles moyennant certaines précautions –, l’insuffisance des moyens alloués au Défenseur des droits pour bâtir un suivi périodique. Du coup, les autorités qui évoquent la lutte contre les discriminations se contentent trop souvent de généralités sans jamais les définir. Le public confond largement inégalités et discriminations.
L’idée prévaut encore que la seule discrimination possible serait volontaire, directe, explicite. Nous sommes en cela tributaires de la loi Pleven de 1972, qui aura 50 ans l’an prochain : elle a modifié la loi sur la liberté de la presse de 1881 en introduisant la notion d’incitation à la discrimination raciale, privilégiant ainsi l’expression publique, signée, volontaire. Elle punissait par ailleurs les agents dépositaires de l’autorité publique qui avaient refusé « sciemment » un droit en fonction des origines du demandeur, à charge pour la victime de démontrer cette intention au pénal.
Au total, le bilan de la loi de 1972 est plutôt maigre. À l’ère des nouveaux médias, elle est minée par l’« effet Zemmour » : même condamné, le publiciste trouve dans le procès une tribune supplémentaire pour se poser en martyr de la liberté d’expression.
La notion de discrimination indirecte a beau figurer dans le droit français depuis 2001, avec une définition précise inscrite dans la loi de mai 2008, elle reste largement ignorée, et cette ignorance va souvent de pair avec un bel aplomb et beaucoup de mépris. En témoignent les pamphlets de Pierre-André Taguieff.

Ils ne font jamais allusion aux résultats des expériences scientifiques sur le sujet mais basculent d’emblée dans un registre psychologique et moral pour fustiger ceux qui osent dénoncer les discriminations ethno-raciales indirectes ou systémiques : « fantasmes », « ressentiment », « attitude victimaire », « haine de l’homme blanc », « bêtise », « folie », etc. C’est la double peine pour les cibles de ces injures : elles ne sont pas seulement exposées aux discriminations, elles doivent essuyer le déni abrupt de leur expérience vécue. Que faire quand on vous ferme ainsi toutes les portes ? L’affaire de Grenoble illustre l’abîme qui sépare l’expérience vécue des discriminations et leur dénégation par des essayistes en chambre. Le jour où elles se heurtent de front et c’est le clash.
Outre le déni des discriminations, le dernier chapitre de votre livre est consacré au déni de l’histoire coloniale. Que pensez-vous de sa prise en charge par Emmanuel Macron, face, par exemple, à la colonisation de l’Algérie ?
L’attitude du président marque un indéniable progrès par rapport à ses prédécesseurs. La mission mémorielle confiée à Benjamin Stora va dans ce sens, de même que la nomination ce mois-ci de l’historien Pap Ndiaye à la tête de l’Établissement public de la Porte Dorée, qui héberge le musée national de l’Histoire de l’immigration, et dont je préside le conseil d’orientation.
On a tôt fait de critiquer la politique macronienne du « en même temps ». Mais faut-il se plaindre que le locataire de l’Élysée ait conscience que les vérités historiques ne sont pas binaires ? Dans son hommage à Samuel Paty, il ne s’est pas contenté de défendre le principe des caricatures, il a aussi rappelé la nécessité de regarder notre histoire en face, « avec ses gloires et ses vicissitudes ».
Mon livre le prend au mot, car je pense que la France ne s’abaisse pas, tout au contraire, à explorer toute son histoire, y compris coloniale, et à l’enseigner. Il faut reconnaître les faits en toute lucidité, sans déni ni repentance.

Encore faut-il que les programmes scolaires et les ressources documentaires suivent, avec une réelle ouverture des archives. Pour prendre un exemple personnel, c’est tout récemment que j’ai pris conscience de la réalité du mandat français en Syrie, avec ce qu’on appelle pudiquement l’« affaire Sarrail », du nom du général nommé en 1924 haut-commissaire des États du Levant. La révolte du djebel druze s’était étendue au nord de la Syrie et Sarrail ordonna de bombarder Damas, reconquise en deux ans avec un bilan de 10 000 morts côté syrien et 2 500 côté français.
On pourrait évoquer aussi la fin piteuse du mandat en mai 1945 : les troupes sénégalaises envoyées par De Gaulle pour s’assurer de Damas ont bombardé et pillé la ville, alors que la Syrie avait déjà un gouvernement reconnu par les Alliés. Elles ont dû se retirer sous la pression d’un ultimatum britannique. Qui s’en souvient en France, à part quelques spécialistes ? Nous sommes amnésiques, mais, là-bas, la mémoire est vive.
Au long du XIXe siècle, dans l’ivresse des premières expéditions coloniales, d’illustres écrivains et savants renommés ont tenu sur les musulmans des propos d’une violence inouïe, digne des fatwas qui prônent aujourd’hui le « djihad global ».
Je cite ainsi Louis Veuillot, Alfred de Vigny, Guy de Maupassant, Ernest Renan, tous convaincus que la civilisation française et/ou le christianisme allaient forcément éradiquer l’islam de la surface de la terre. Les musulmans n’avaient d’autre alternative que la conversion ou la mort.
Rares sont les voix qui se sont élevées en sens contraire. En 1903 et 1908, Jaurès s’inquiétait de l’effet des expéditions coloniales sur le monde musulman, de l’Inde au Maroc : elles ne manqueraient pas de pousser les populations vers l’extrémisme.
La liberté d’expression des professeurs vous paraît-elle aujourd’hui menacée ?
Il règne autour de cette question une grande confusion. Un professeur qui s’abstient de montrer une caricature obscène de Mahomet à des élèves de quatrième fait-il preuve de lâcheté ou de respect ? Éviter l’outrage gratuit, l’offense pour l’offense, c’est respecter le droit. C’est se comporter d’une manière civilisée. Le dilemme n’est pas le courage versus la lâcheté. Jean-Michel Blanquer lui-même, dans son entretien mémorable au JDD, une semaine après l’assassinat de Samuel Paty, a beau proclamer que « la lâcheté n’est plus de mise », il refuse d’introduire les caricatures de Mahomet dans les manuels : « Il faut respecter la liberté pédagogique et éditoriale. » Ce recul fait-il de lui un « islamo-gauchiste », un « idiot utile » du « djihadisme d’atmosphère » [expression forgée par Gilles Kepel –ndlr] ?
Même dans les périodes les plus libres de notre histoire, il y a toujours eu des limites à la liberté d’expression. La règle d’or qui a inspiré les révolutionnaires de 1789 a été de juger qu’on ne pouvait pas réclamer un droit en le déniant à autrui. Cela vaut pour la liberté d’expression comme pour celle de religion.
Dans mon ouvrage, j’entre dans le détail des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, qui est très offensive en matière de liberté d’expression, puisqu’elle a jugé qu’on pouvait offenser quelqu’un pour son bien, par des caricatures caritatives en quelque sorte. Mais l’application concrète de cette jurisprudence est d’une grande prudence ; elle tient compte, parfois à l’excès, des circonstances nationales ou locales.
Je réfute l’idée – devenue dominante – selon laquelle on pourrait outrager les croyances sans outrager les croyants. Le Figaro a rendu compte de mon livre en titrant que je m’opposais à toute « offense » à l’égard des musulmans. Je n’ai jamais rien dit de tel. Dans une société démocratique et pluraliste, les croyants savent bien qu’ils ne sont pas à l’abri de critiques véhémentes contre leurs croyances.
Ce qui est condamnable, en revanche, c’estl’outrage pour l’outrage, le dolus specialis, comme disent les juristes. La « critique des religions » tend à couvrir désormais un spectre aussi disparate que le libre examen des textes sacrés, la réfutation des dogmes, la dénonciation des exactions commises au nom de la religion, les insultes, les gestes avilissants, les enculades.
Comment peut-on accepter une telle confusion ? La politique du doigt d’honneur ou du bras d’honneur n’est pas une « critique », elle ne fait pas avancer le débat démocratique cher à la Cour européenne des droits de l’homme, elle le fait régresser. Des distinctions sont nécessaires, qui exigent le sens de la mesure, le sens du discernement. Avilir autrui à travers ses croyances ne prépare pas les écoliers de la République à vivre ensemble. On n’y parviendra qu’en appliquant la règle d’or du respect mutuel.
Un sondage récent de l’Ifop pour le compte de la Licra montre que les lycéens ont une expérience quotidienne de la diversité que n’avaient pas les générations précédentes et qui les rend plus tolérants que leurs aînés. Ainsi, la majorité juge normal qu’une mère voilée participe à des sorties scolaires. Si ces résultats ne sont pas toujours faciles à interpréter, je retiens que l’approche unilatérale de la nouvelle laïcité produit l’inverse des effets recherchés.
Une objection répandue est qu’il n’y a aucune équivalence à faire entre le dessin satirique, si offensif soit-il, et les armes meurtrières des djihadistes.

Cela va de soi : un crayon n’est ni un couteau, ni une kalachnikov – même si Charb, par exemple, mettait en parallèle « la violence systématique des extrémistes » et « la liberté de nous marrer sans aucune retenue ». Mais ce n’est pas une raison pour établir une autre équivalence, selon laquelle tout serait possible à l’encontre d’autrui pourvu qu’il n’y ait pas « mort d’homme » : on se souvient de cette formule employée par Jack Lang pour minimiser l’agression de Dominique Strauss-Kahn contre Nafissatou Diallo.

Quels sont les principaux conseils que vous donneriez à vos collègues professeurs, notamment à celles et ceux qui débutent dans le métier, parfois avec beaucoup d’appréhension ?
D’abord, tenir compte des caractéristiques des élèves : leur âge, leur maturité, leurs origines – non pas pour les enfermer dans leur identité – très évolutive à cet âge – mais pour prendre la mesure de l’effort à accomplir, des gradations à respecter. Ne pas montrer n’importe quoi à n’importe qui.
Des professeurs m’ont adressé leurs programmes d’éducation morale et civique (EMC) et j’ai été frappé de leur qualité. Permettez-moi de citer des extraits d’un courrier reçu le 1er novembre 2020 d’une professeure de philosophie qui officie dans un lycée de Seine-et-Marne. Ils contiennent des éléments utiles.
« L’EMC est centrée sur l’étude de la citoyenneté […]. Il s’agit d’étudier les conditions dans lesquelles s’élabore la décision publique, en tant qu’elle est conditionnée par l’intérêt général, ce qui revient à essayer de comprendre quels sont les arbitrages qui ont conduit à fixer certaines lois, à rendre certains jugements, à orienter certaines politiques publiques, et ceci de façon tout à fait descriptive. »
[…]
« Les sujets à étudier, en vrac : l’euthanasie, la GPA, le statut de l’embryon, l’eugénisme, le droit de ne pas être né, mais aussi la régulation des drogues, les “scandales” de l’hormone de croissance, du Médiator, du sang contaminé, l’interdiction des signes religieux à l’école, et bien sûr depuis 2015 l’affaire Charlie Hebdo, mais aussi les accords internationaux et le réchauffement climatique, le syndrome NIMBY, etc. »
« Ça peut sembler hétéroclite mais l’objectif est toujours de chercher à identifier les antagonismes, les enjeux croisés, de confronter les principes et les conséquences, pour s’efforcer de définir ce que l’intérêt général peut commander en l’espèce. Apprendre à suspendre son jugement pour s’arrêter sur les données d’un problème tel que l’autorité publique s’y trouve confrontée, en partant du principe que cette autorité, c’est moi, le citoyen, qui l’exerce. »
[…]
« Dans ce cadre, le cas de la liberté d’expression n’est qu’une entrée parmi d’autres, étant donné les nombreuses limites apportées à ce droit qui ressortit à la “liberté des modernes”. D’ailleurs, nous sommes en général plutôt invités à rendre les élèves attentifs à ces limites, celles de l’incitation à la haine raciale, de la négation de crime contre l’humanité. Du jour au lendemain, on entend sacraliser la liberté d’expression alors que celle-ci a longtemps été l’objet d’une grande circonspection. »
Remarquable témoignage d’une enseignante qui prend son métier à cœur. Il montre à quel point la polarisation des débats sur les caricatures de Mahomet et sur la liberté d’expression aboutit à rétrécir le champ de vision de l’éducation civique et morale. Les professeurs dignes de ce nom peuvent difficilement accepter qu’une doctrine officielle sur la liberté d’expression leur soit imposée par le ministère. Les valeurs fondamentales, ici, sont le pluralisme et le libre examen.
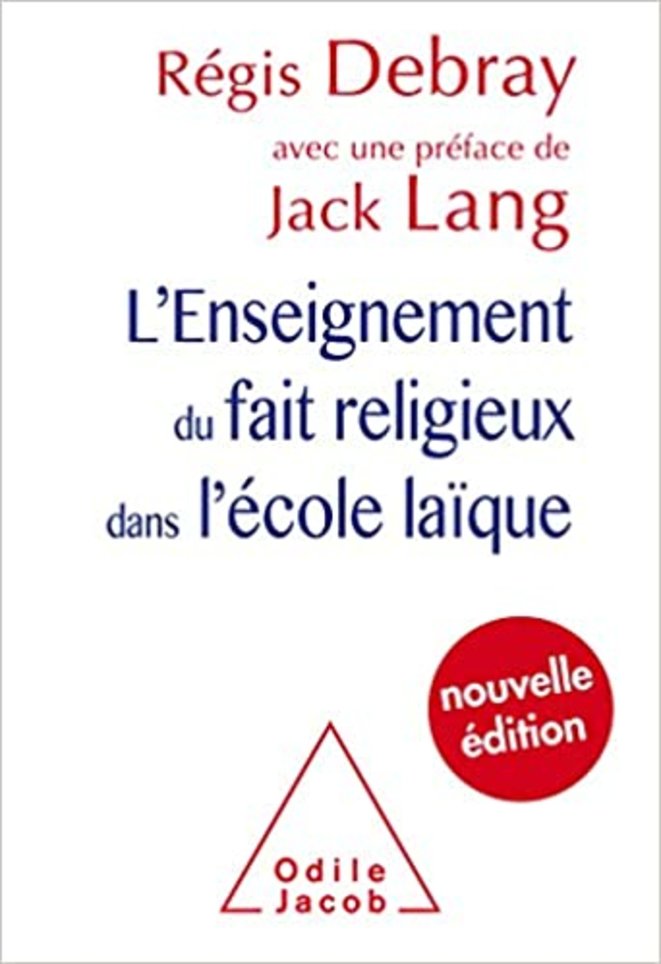
Par ailleurs, comme Régis Debray, je suis partisan d’enseigner le « fait religieux » à l’école. Non pas les religions mais leur histoire et leurs figures. J’ai entendu un jour au Louvre un enfant demander à sa mère : « Maman, qu’est-ce qu’il fait, le Monsieur, sur ce poteau ? » Il s’agissait du Christ en croix. Cet illettrisme culturel n’est pas admissible. Si athée que l’on soit, on devrait être capable d’admirer la chapelle Sixtine en connaissance de cause.
Je pense, enfin, que la République reviendra à ses fondements si elle se penche avec la lucidité et la réflexivité nécessaires sur ses défaillances passées : pourquoi a-t-elle mis tant de temps à franchir la barrière du genre pour mettre en application les libertés fondamentales ? Pourquoi les a-t-elle refusées aux indigènes des colonies ?
C’est le silence persistant sur ces phénomènes qui a engendré l’« indigénisme ». Comment expliquer que la France ait attendu 24 ans pour ratifier la Convention européenne des droits de l’homme, et 30 ans pour autoriser le recours individuel devant la Cour de Strasbourg, alors que l’idée d’une garantie européenne des droits avait été portée, après-guerre, par un Français, Pierre-Henri Teitgen, grand résistant, garde des Sceaux à la Libération ?
À propos de la décapitation de Samuel Paty, vous évoquez « une scène de crime piétinée par la polémique ». Qu’est-ce que cela signifie ?
La polémique sur « l’islamo-gauchisme » puis sur la laïcité, dans les jours immédiats qui ont suivi l’attentat, a déplacé les questions que cet attentat aurait dû susciter. Au lieu de se concentrer sur le tueur, sa trajectoire, son expérience du système éducatif, le mécanisme de sa radicalisation, les réseaux qu’il fréquentait, on a voulu détourner le regard sur une prétendue « complicité intellectuelle » des sciences sociales avec le terrorisme – notion inconnue du droit français –, comme si des auteurs « indigénistes », « décoloniaux » ou « intersectionnels » avaient pu armer intellectuellement le jeune Abdoullakh Anzorov.
Relisez les déclarations de Jean-Michel Blanquer : elles alignent une série d’expressions évoquant des causalités floues et insaisissables, dignes des vertus inflammatoires du phlogistique – cette théorie chimique qui expliquait la combustion par la présence d’un élément-flamme dans les corps combustibles –, le contraire d’une analyse scientifique de la causalité : « complicités intellectuelles », « matrice intellectuelle », « terreau d’une fragmentation de notre société », « vision du monde qui converge avec les intérêts des islamistes ».
Sans oublier les inévitables « idiots utiles », d’autant plus efficaces qu’ils ne savent pas ce qu’ils font. Savoureux paradoxe : ceux qui utilisent un tel vocabulaire sont les premiers à juger nébuleuse et fantasmatique l’existence des discriminations indirectes. Le seul moyen de trancher la question serait d’établir les faits objectivement. Mais c’est impossible quand on manie uniquement la logique du soupçon et le procès d’intention.
Frédérique Vidal a annoncé une enquête en milieu universitaire pour faire la part de la science et du militantisme. Qu’en pensez-vous ?
J’observe qu’il y a de grands militants parmi les pétitionnaires qui prétendent purger la science de tout militantisme. Lecteur attentif de Pierre-André Taguieff, j’ai du mal à croire qu’il puisse incarner la figure du chercheur détaché de toute passion militante. Libre à lui de s’engager. Mais libre à moi de jeter un regard amusé sur tous ces militants qui militent contre le militantisme ! On en finirait par oublier que les deux ministres porteurs de ce projet purificateur sont eux-mêmes – ce qui est leur droit – des enseignants-chercheurs passés à la politique.
En réalité, bien des raisons peuvent pousser des hommes et des femmes à s’engager dans les sciences sociales : une certaine idée de la justice sociale, la volonté de dévoiler l’intérêt caché ou les mécanismes du pouvoir, la solidarité planétaire, la défense du patrimoine culturel, l’interrogation sur leur place personnelle dans la société, etc.
Pour avoir dirigé un organisme de recherche pendant dix ans, je confirme que tous ces profils existent, qu’ils peuvent se mêler et évoluer au cours de la carrière. Où est le mal ? L’essentiel est qu’au bout du compte l’activité scientifique, fût-elle engagée, adopte une méthode solide, brasse des données, recoupe des archives, produise des connaissances, soulève des hypothèses stimulantes et vérifiables.

Max Weber lui-même n’a pas séparé le savant du politique autant qu’il l’a proclamé : son activisme politique était intense et on a même songé à lui comme chancelier d’Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Durkheim militait dans la Ligue des droits de l’homme et travaillait pour une organisation qui accueillaient les juifs de l’Est fuyant les pogroms.
Raymond Aron, Alain Touraine, Raymond Boudon, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, François Furet et bien d’autres étaient-ils de purs scientifiques ou poursuivaient-ils un objectif politique et social plus large ? Je souhaite bien du plaisir aux inspecteurs diligentés par Mme Vidal qui viendraient scruter les activités de chaque universitaire en sciences sociales pour tracer la frontière entre science et engagement. Ces inspecteurs devront d’abord élucider leur propre cas : mission scientifique ou mission politique ? Et se demander, avant de l’accepter, s’il n’y a pas mieux à faire aujourd’hui pour relever les défis de la recherche française.


